-
Courtisane - suite 2
Je me souvenais de l'entrée du restaurant Jen. Derrière, on se retrouvait dans un long corridor bordé de loggias. C'était là que se cachait la maison des courtisanes. Le soir, les lampes et les bougies scintillaient partout. Les filles maquillées, aux vêtements chamarrés, se penchaient à la balustrade près des avant-toits et attendaient d'être choisies par les clients. Dans ces nuits, l'alcool de riz épaississait nos propos, qui se voulaient logiques mas qui, dans ce lieu, étaient absurdes, indécents. Wen-K'i, que mon oncle tenait par la taille, balançait son corps au son de la musique. Elle se moquait de nous et nous rappelait que nous délirions bien plus dans le flot de nos paroles que dans les couches humides. J'oubliais un instant ce qui m'entraînait si souvent dans ce lieu, je reculais l'instant de la volupté partagée avec d'autres corps que le sien.
Un jour d'hiver, mon oncle tomba malade. Rien de grave, mais il fut alité toute une semaine. Dans la journée, je faisais prendre de ses nouvelles. C'était un prétexte pour me rendre, le soir venu, à la maison de courtisanes et rencontrer Wen-K'i. Sur la loggia, elle tendit les mains et me parla sans que je l'entendisse tout à fait. Je lui parlais de la santé de mon oncle et je répondais au hasard à ses questions. Elle ne remarqua pas mon trouble ou feignit de l'ignorer. Nos rencontres avaient toujours revêtu cette réserve et bien que l'émotion fût présente, nous n'en parlions pas. Je repensais au poète : « Il n'y a là qu'une vérité mais en voulant la dire, j'en ai oublié les mots. » Je regardais Wen-K'i se courber pour cueillir une orchidée dans le jardin d'hiver et le mouvement de sa main flottait à l'infini, depuis le ciel jusqu'à la terre. La fleur pourtant était déjà coupée et la main la tenait. Wen-K'i m'avait toujours beaucoup parlé et peu écouté. Ce n'était pas qu'elle ne prêtât pas attention à mes paroles, mais naturellement, en sa présence, je parlais peu. Par ses paroles, Wen-k'i tissait un voile entre nous et moi, en oubliant les mots, j'épaississais ce voile. Nous avions involontairement créé les conditions pour ne jamais écouter nos désirs. Ce soir-là, Wen-K'i était une déesse. Diaphane, incertaine. Cette transparence venait plus du velouté de sa peau, que de sa chair. Les plis de sa robe accentuaient les formes pleines de son corps. Elle avait déchaussé ses sandales et j'admirais la courbure de son pied parfait, l'ombre des doigts, de la plante, posée là sur le sol. Cette nuit-là, ce sont nos corps qui tombèrent les premiers sur sa couche, nos âmes au loin se perdirent. Nous avons jeté des cris de désir et de désespoir au cœur des ténèbres. Jamais l'amour n'atteignit sa profondeur ailleurs qu'en ce lieu et ce temps interdits.
Mon oncle guérit vite et je m'empressais de quitter la ville, sur un de mes bateaux. Je décidais de naviguer dans les villes coloniales de la Mer de Chine, pour m'enrichir. Pour oublier. Lorsque je revins, Wen-K'i me reçut sans laisser paraître de trouble, sans me questionner. J'en conclus qu'elle avait oublié. Je disparus quelque temps de la maison des courtisanes. Lorsque j'y revins, j'étais marié, je me fréquentais par conséquent très rarement le lieu des plaisirs.
A la mort de mon oncle, Wen-K'i reçut en legs le pavillon du lac et une petite concession de sel. Elle décida de quitter la maison des courtisanes et de se retirer dans ce paysage minéral et aquatique. Elle avait trente ans. Durant quinze ans, elle avait vécu dans la maison des prostituées. Jamais son teint ne s'était fané et ses gestes, son attitude avaient conservé toute leur spontanéité. C'en était inconvenant à force d'innocence. Lorsqu'elle rejoignit la maison du lac, une petite cour l'accompagna depuis la ville pour fêter sa nouvelle vie. Chaque été, certains faisaient le pèlerinage jusqu'à elle. Je n'y venais qu'un seul été. Je lui annonçais la naissance de mon premier fils. Elle me regarda et je soupçon-nais une immense tristesse planer dans son regard qu'elle détourna tout aussitôt pour goûter au thé vert posé dans la tasse en porcelaine blanche sur le guéridon de la véranda. Je scrutai tous ses gestes et je compris bien plus tard que je l'avais blessée. J'oubliais Wen-K'i. Mes années de marchand, mes années d'époux et de père de famille, m'éloignaient d'elle. Il m'arrivait de voir son regard lorsque je me tenais assis dans un train qui me conduisait à Shanghai, de m'endormir en entendant sa voix me souhaiter le bonsoir, de sentir son odeur dans un jardin de Hangzou, d'oublier qui j'étais.
à suivre
-
Commentaires
Nuits blanches
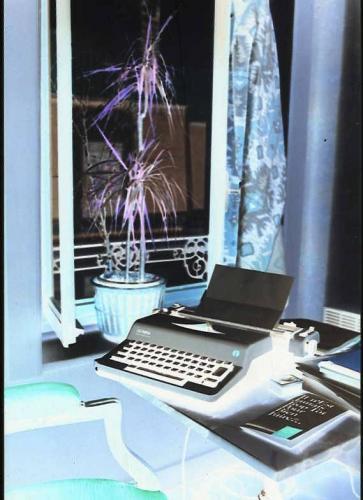
 Twitter
Twitter del.icio.us
del.icio.us Facebook
Facebook Digg
Digg Technorati
Technorati Yahoo!
Yahoo! Stumbleupon
Stumbleupon Google
Google Blogmarks
Blogmarks Ask
Ask Slashdot
Slashdot