-
Le pianiste au fond du bar
Dans le bar, le pianiste s'est levé, il délaisse le piano, tout noir. Au comptoir, les lumières sont éteintes. Dernier whisky. « Un yiddish, Raph ! Double sec. » Il a la voix des mauvais jours, le pianiste, la voix enrayée des soirs de solitude quand le café, noir de fumée, étale ses tables désertes et ses allées poussiéreuses et grasses. Le pianiste tourne le dos à l'instrument, à quoi bon la musique sous les doigts quand la tête tourne en carafe fêlée. Rien que du vide égratigné d'impuissance. Tiens, il y a encore une table occupée. Le dernier consommateur penche sa tête sur ses bras assoiffés des autres, qui vont ailleurs, là où la fête résonne encore. Dans les rues, les passants sautent de flaques en flaques. Les voitures valsent entre les mêmes flaques, petites étendues d'eaux avant les grandes eaux.
Eaux promises dans les villes. Trottoirs de la ville où un homme seul traîne son manteau vert et trempé. Il baisse la tête. Son col relevé cache une chevelure, blonde peut-être. Il est pressé mais hésite au carrefour. Il s'arrête devant le café. Viendra-t-il encore une fois rejoindre son ami le pianiste ? N'a-t-il pas déjà assez entendu sa voix fêlée raconter de vieilles amours ordinaires comme toutes les amours des autres ? La lumière filtre, il faut entrer à nouveau, pour écouter le vieux crooner obligé de réciter des fables que Casanova aimerait inscrire dans le livre IV de ses aventures. Temps de la vie d'un homme qui ingurgite l'histoire des autres, parce qu'il est de passage et qu'il n'aura pas le temps de créer sa propre histoire dans cette ville où coulent deux fleuves inlassablement traînés vers la mer.
Mer Méditerranée. Lourdeur avant la pluie. Des chants grecs. Pourquoi la Grèce maintenant ? Le téké s'égrène, parodie de quelques pas. Les marins grecs ont posé leurs mains aux poils noirs sur leurs genoux en toile marine. Les chaises sont repoussées contre le mur et chacun regarde le centre de la salle. Le premier qui se lève est vieux, son visage est tanné. Il trace deux, trois gestes avec le bout de son pied botté, léger sous le cuir épais. Deux ronds, comme ça et les reins se redressent, les mains se joignent. Il livre là sur le carreau du café sa leventia, tout son honneur, toute sa liberté. La liberté et la mort aurait écrit Kazantsaki. Les autres applaudissent, attentifs à ces mouvements improvisés mais tellement saccadés qu'on voudrait qu'ils reproduisent des pas initiatiques. Et les têtes approuvent le vieux danseur. Il tourne, comme un derviche, il a fumé du noir c'est certain. Il tourne, le bras droit levé au ciel et le gauche pointant la terre. Il tourne d'un mur à l'autre. De quel visible à quel invisible ? Le jeune palikare le rejoint. Son pas est plus précis, plus rythmé. Il tourne sur lui-même en un mouvement qui s'amplifie. Toute la Méditerranée boudeuse dans sa tête. Il entend aussi les pleurs de sa mère quand le typhus a rongé le petit dernier. Et quand le père est revenu, la main coupée par le filet alourdi de poissons. Lamentations et plaintes. Pire encore, quand Fotini lui a jeté un regard noir le jour de la fête du vin. Le jeune il veut oublier toutes ces tentations du désespoir et le vieux, lui, il attend que le souvenir de la Mangkissa lui gonfle encore les entrailles. Et là, le vieux Daïs entame le chant du kaïmos. Vous l'entendez comme il pleure sa vie, ses souvenirs, ses chagrins, tout son vague à l'âme jusqu'à l'extase mystique, pas celle des saints, mais celle quand il la tenait la Mangkissa entre ses reins. Croire que la vie est encore là, bien recroquevillée dans son ventre et le pope peut bien crier que c'est des danses païennes, le vieux il s'en fout. Il est près à baisser sa culotte de cheval devant le pope et lui crier foutaises ! La vie c'est là qu'elle est. Il rit, découvrant sa mâchoire édentée, il tâte ses parties, on pourrait croire que son sexe va se dresser. Pas vrai, mon gars ? Allons encore du vin de résine.
Raph repousse le bouton. Le pianiste a fait un geste las, plus de musique pour cette nuit. Quelle heure est-il ? Deux heures peut-être ? Oui, deux heures. Seulement deux heures. La nuit est longue, l'hiver. Je déteste la nuit. Elle n'en finit plus. Qu'est-ce que je te raconte ? Ce whisky aura ma peau mais avant il me rendra fou. Bien sûr que j'aime la nuit avec son monde d'hommes qui croisent le côté cour du décor. Côté jardin, les feuillages, les églises, les boutiques. Côté cour, du carton-pâte. Tu appuies ton doigt, là sur une façade et crac, de la poussière. Rien de plus. Allons, fais pas cette tête, que voulais-tu trouver ? Un peu de poussière, je te dis. Poussière qui colle à ta peau et, un jour de jadis, c'était l'ongle de Michel-Ange ou celui d'Attila qui a creusé un sillon.
-
Commentaires
Nuits blanches
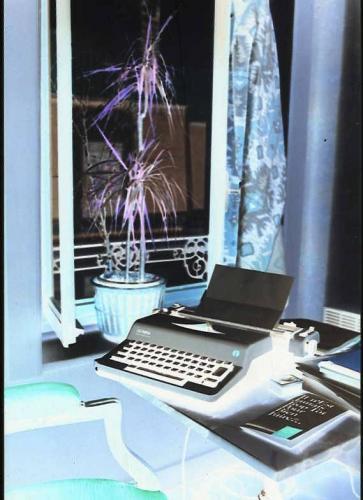
 Twitter
Twitter del.icio.us
del.icio.us Facebook
Facebook Digg
Digg Technorati
Technorati Yahoo!
Yahoo! Stumbleupon
Stumbleupon Google
Google Blogmarks
Blogmarks Ask
Ask Slashdot
Slashdot