-
Par Corinne Valleggia le 26 Septembre 2007 à 22:09

"Père, pardonne-leur : ils ne savent pas ce qu'ils font."
Évangile selon Luc
"En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis."
Évangile selon Luc
A sa mère : "Femme, voici ton fils". A son disciple : "Voici ta mère."
Evangile selon Jean
"Eli, Eli, lama sabactani ?"
"Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?"
Évangiles selon Marc et Matthieu
"J'ai soif"
Évangile selon Jean
"Tout est accompli."
Évangile selon Jean
"Père, entre tes mains je remets mon esprit''.
Ayant dit cela il expira.
Évangile selon Luc votre commentaire
votre commentaire
-
Par Corinne Valleggia le 27 Juin 2007 à 20:17Dans la rue, les piétons avancent sous la grosse horloge. Leurs démarches n'est pas toujours la même : certains vont tète baissée, d'autres traînent les pieds, un tel regarde les vitrines, tel autre les fesses des femmes. Une se tord la cheville en courant sur ses talons aiguilles. Un relève son chapeau pour goûter au ciel. Chacun, pourtant, a dans la tête la même préoccupation : avancer, prendre le chemin le plus court pour rejoindre sa destination. L'horloge, l'œil en cyclope, les dévisage, en suit parfois un plus longuement pour deviner où va sa course. Mais elle est coincée là-haut, à ne rien faire. Impossible de courir, ni même de dormir : son œil s'ouvre tout le jour et toute la nuit. Ne pas dormir ne la gêne pas vraiment. Son regret, qu'on entend dans ses soupirs, c'est de ne pas pouvoir rêver. Elle s'empare alors des rêves des passants qui vont plus bas au-dessous de son cercle noir. Tantôt, elle devient pianiste aux belles mains, tantôt belle ouvrière aux mains habiles. Parfois, elle a la jambe ronde d'une jeune femme, ou d'autres fois le pantalon droit d'un homme d'affaires. Elle vit toute leur vie en un clin d'œil, le temps que le passant surgisse du coin de la rue et passe en-dessous pour disparaître dans le vide derrière elle. Derrière. La magie de ce monde qu'elle ne voit pas : la rue est-elle encore longue ou s'interrompt-elle tout à coup ? Peut-être débouche-t-elle sur une place ombragée où jouent des enfants, avec des balançoires, des tourniquets et un marchand de glaces. Ou bien encore la bâtisse blanche d'un ministère aligne le long du trottoir ses fenêtres hautes à petits carreaux : le ministère de l'heure et des horloges.
Un jour -l'horloge s'en souvient comme si c'était hier- l'aiguille de ses heures s'est perdue. Bientôt, l'aiguille de ses minutes s'est détachée elle aussi. Il n'est resté que le cadran vide et absurde qui a continué de fixer les passants avec ses chiffres romains devenus muets. Tous les passants ont oublié qu'autrefois ils réglaient leurs pas sur elle. Le matin, ils se pressaient, tandis que le soir, ils prenaient le temps de la saluer avant de regagner leur logis. Maintenant, les piétons oublient tout simplement de lever les nez et si, par habitude, ou par hasard, ils jettent encore un regard distrait là-haut, ils s'irritent contre cet objet laid qui a perdu sa fonction. On ne peut pas me laisser comme ça éternellement, soupire-t-elle. Eternellement ! Le temps s'aplatit dans sa tête. Quand elle tournait rond, au fond elle n'y pensait pas au temps. Elle laissait faire. Parfois, elle remarquait : « Tiens, trois heures moins onze, le petit monsieur n'est pas encore sorti de son allée pour prendre le tramway. Il sera en retard aujourd'hui. » Elle sourit en pensant qu'autrefois, elle s'irritait quand l'aiguille des minutes paressait et prenait du retard. Elle grommelait et le tictac bourdonnait plus fort. Elle espère qu'un jour un passant, obsessionnel de l'ordre, lèvera les yeux sur elle et pensera : bizarre, cette grosse horloge n'a pas d'aiguilles. Il en aura des frissons parce que l'étrange, surtout dans les petites choses de la vie, étourdit. Ou bien, il y aura un fonctionnaire zélé, on en trouve partout, qui aura remarqué l'absence d'aiguilles et signalera cette anomalie au bureau des horloges de la ville. En attendant l'horloge continue de poser son regard cyclope au dessus des passants. La nuit tombe et elle soupire à la lune qui ne la voit pas.
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par Corinne Valleggia le 27 Mai 2007 à 22:47
Elle se tenait debout devant ma bibliothèque et je la voyais poindre son révolver dans ma direction. J'étais incapable de savoir si, oui ou non, l'arme était chargée. Je me contentais de me tenir à l'abri derrière le dossier de mon fauteuil, à genou sur le plancher, dans un geste de suppliant. Entre ses phrases criées, indistinctes, le silence de mon bureau. Dehors, sur les quais, les voitures attendaient que le feu passât au vert. Il m'était impossible de me pencher à la fenêtre de mon cabinet pour crier aux conducteurs dans quel danger je me trouvais, ce vendredi vers 14 heures en plein cœur de la cité. J'attendis encore dans cette fâcheuse posture que la jeune femme se calmât. Au fond, je savais qu'en aucun cas je n'aurais pu jeter au monde un « sauvez-moi », j'étais trop dépité de me retrouver ainsi dans la pointe de mire d'une patiente qui me tenait à sa merci et qui me faisait goûter à l'effarement.
J'évoquais un bref instant le regard de mes pairs penchés sur cette scène qui n'avait rien de biblique. Cette ligne de mire me remettait en cause, et pour tout dire me reléguait au ban de ma société.Retour arrière. Je suis psychanalyste, freudien. J'exerce dans mon cabinet à titre indépendant, je consulte également à l'hôpital psychiatrique des Pénitents, grande bâtisse XIXe, bordée de son parc ombragé à l'entrée de la ville. Enfin, le mardi et le jeudi, je professe à l'université pour les étudiants du DESS de psychologie clinique. J'ai acquis en vingt années de métier une solide réputation, la confiance de mes pairs, le respect, voire l'admiration, de mes étudiants, et de réels progrès de mes patients. J'accumule avec mes conférences, mes articles, une certaine notoriété, au moins dans le petit monde de la psychanalyse freudienne, qui dépasse le cercle de ma ville provinciale et remonte par les courants jusqu'à Paris, où certaines de mes hypothèses, pas encore des théories, sont commentées dans la presse spécialisée. Je peux, sinon m'enorgueillir, au moins me satisfaire de mon parcours et, les nuits d'insomnie, énumérer mes brillantes étapes.
Lorsque j'ai reçu Patricia pour la première fois dans mon cabinet, j'étais parfaitement conscient de ses difficultés psychologiques. Patricia est une jeune femme de vingt-quatre ans, plutôt jolie, à la bouche peut-être trop fine -certains vous diront qu'elle dénote son manque de confiance mais je n'aime pas les raccourcis trop rapides. De longues jambes, un corps élancé, une courte chevelure brune. Des cils épais, un regard... voilà c'est ça qui frappe : son regard, lointain et vague. Lorsqu'elle vous regarde, Patricia vous annonce non pas des tempêtes mais des orages d'été : ceux qui apaisent quand la tension de la chaleur a été trop forte. Au cours de ce premier rendez-vous, je l'ai écouté exposer dans un long monologue -les monologues se prêtent à ma profession plus que les dialogues- ses difficultés, ses souffrances, en mots courts et essoufflés. Patricia appartient à une famille plutôt bobo, comme on dit, ouverte à la psychanalyse, relativement cultivée, son père est architecte.
Patricia a été quelque temps étudiante aux beaux arts, puis en littérature comparée, et finalement en ethnologie. Rien de concluant, me dit-elle, ses difficultés de vivre l'empêchant de conclure dans ses études. Je l'ai écouté avec toute l'attention que ma profession nécessite. J'avais déjà compris par sa présentation hachée, ses respirations, ses détournements, que je n'avais pas affaire à une patiente habituelle. Il est bien connu que la cure psychanalytique ne soigne que les névroses, quand elle y parvient. La règle est simple : en cabinet, un freudien ne soigne pas les psychoses, obligation de se référer à un autre cadre. La déontologie de l'obédience freudienne, à laquelle j'adhère pleinement, est très explicite sur ce point. Je n'ai qu'à m'y conformer et à renvoyer Patricia auprès du Centre des Pénitents. Rien d'autre à décider. Au lieu de quoi, orgueil, direz-vous, je me remémorai mes récentes hypothèses, tout mon parcours -je ne vous le refais pas une deuxième fois- et je déclarai en un claquement de doigts : « J'ai une place pour vous, les vendredis à 14 heures, cela vous conviendrait-il ? » C'est ainsi que Patricia, une patiente psychotique, entama une cure psychanalytique dans mon cabinet.
C'est ainsi que, ce vendredi, je me retrouvai dans sa cible de mire. Impossible d'appeler au secours, je tentai de lui parler, mais les mots ne venaient pas, seules défilaient des images, des sons, la sortie de mes élèves après mes cours, leurs questions, les tentatives de séduction de certaines de mes plus jolies élèves, les échanges avec les autres membres de mon groupe psychanalytique. « Comment avez-vous pu, vous, enfreindre à notre déontologie ? », j'entendais déjà la présidente du groupe m'invectiver. Tout cela ne me donnait pas la réponse à ma situation qui empirait. Je regardais Patricia, debout, l'arme pointée dans ma direction. J'étais désarmé. Toute mon intelligence, toutes mes théories s'évanouissaient. Je vacillais, j'allais devenir fou, oui, moi aussi, j'allais devenir fou. J'en aurais pissé dans mon froc. Comment faire pour sauver ma peau, enfin sauver la face, et rétablir le dialogue avec ma patiente ? Comment dit-on chez les flics ? Le négociateur. Négocier. Rien. Ca ne sortait pas. Je ressentais une agression si forte que rien ne pouvait lui résister. Et là, croyez-moi, ne me croyez pas, j'ai eu la révélation. Ouais, comme Saint Paul. C'était une évidence : Patricia tentait de me faire ressentir ce qui l'habitait continuellement, le sentiment d'agression qu'elle subissait sans répit, qu'elle éprouvait jusque dans mon cabinet et que son révolver dévoilait. Son geste, dont les ressorts étaient parfaitement inconscients, fit soudain sens. Ma patiente, dans ce détour, avait trouvé le moyen de communiquer avec moi. Dans ce moment, je dépassais l'empathie et je parvins à une symbiose salvatrice. C'est ce que je parvins à lui transmettre. Toute la tension de son geste s'apaisa, délivrée par ma parole. Je réussis à la désarmer. La situation retrouva son équilibre, au moins momentanément : elle la patiente, moi le psychanalyste.
Depuis lors, je poursuis avec Patricia cette tentative de cure et je constate les progrès de ma patiente. Je ne sais pas encore où nous conduira cette expérience, mais je sais désormais que la compassion est une arme efficace pour faire reculer les frontières de la souffrance.
photo : Franck Donat, Rues de Lyon
http://ruesdelyon.wysiup.net/PageRubrique.php?ID=1002420# votre commentaire
votre commentaire
-
Par Corinne Valleggia le 22 Mai 2007 à 22:09
Sur l'île aux deux mers, pendant que Robinson, dans sa cabane, respire les poudres d'or des lys, Or et lys, un drame se trame : dans les souterrains secrets, Vendredi attache à son cou des chaînes de coquillages. Il glisse. Au secours ! Au secours ! répète l'écho. Robinson accourt pour détacher son unique compagnon qui pend stupidement au bout de sa corde de fortune. La vieille lame de Robinson ne coupe plus rien. Ouf, la corde casse. Vendredi tombe et gueule comme un veau après Robinson : 'me laisse pas tout seul, au fond de ce trou, j'ai peur la nuit tu sais.' Robinson se marre et Vendredi rit de toutes ses quat' dents. C'est bon d'avoir un unique compagnon ! Quel privilège, pense Robinson en tranchant la noix de coco. Cette nuit, ils s'endorment dans la cabane au goût d'or et de lys. Vendredi grogne un peu, il se retourne sur ses feuilles de palmiers, ça gratte dans le dos. A quoi rêvent-ils ?

 votre commentaire
votre commentaire
-
Par Corinne Valleggia le 1 Mai 2007 à 22:58
J'ai découvert ce village dans un de mes lointains voyages. J'avais traversé plusieurs contrées jusqu'à ce qu'on me parle de cette histoire qui se déroule dans un pays de champs lointains, avec l'écho des montagnes douloureuses et la voix fraîche des jeunes filles avant les épousailles.
Là-bas demeure un village en pierres dorées, bordé d'arbres au tronc d'ivoire, qui jamais ne frémissent à l'onde du vent mais laissent les oiseaux sauvages s'y poser avant leur ultime destination.
Les hommes y meurent jeunes et les femmes, centenaires, chantent leur gloire éternelle et leur éphémère présence. Elles vont par deux ou trois sur les chemins de terre et portent jusqu'aux arbres sacrés leurs offrandes aux dieux de larme. Muettes tout le jour, elles ne laissent échapper une parole que lorsque le soleil vert a basculé derrière la colline du soir. A la première étoile au bord du cercle opale de la lune, elles chantent une mélodie dans une langue oubliée. Les nimbes blancs de leurs longues chevelures et leurs mains ridées révèlent l'unique marque de la vieillesse : leurs visages inoubliables n'évoquent aucune souffrance. Ni la marque de la mort inévitable, ni les griffes du temps, n'imposent leur courbure maléfique.
Lorsque leur mort approche, avant l'aurore, elles s'éloignent, un sourire flottant à leurs lèvres pâles. Elles vont s'étendre en bordure du fleuve mouvant. Lorsque le soleil vert a repris sa course, les jeunes filles quittent le village avec leurs jarres et leurs paniers. La dernière est seulement chargée d'un flacon scellé, contenant l'huile bénite. Quand elles découvrent le corps de la morte, elles déposent en cercle les jarres et les paniers. De derrière les buissons mauves, elles tirent une litière de roseau tressé. Elles posent leurs mains sur la lisière de la robe en lin que la vieille a revêtue avant son départ. Elles pleurent toutes sans larmes, ni gémissements et la jeune fille au flacon dépose l'huile en gouttes d'or dans la paume des mains, sur les chevilles et sur le front lisse. Après l'onction, l'une après l'autre dépose une fleur de mousse, une goulée du fleuve ou un galet plat sur le corps de la gisante.
Les jeunes filles transportent alors jusqu'au village la litière. Les vieilles, les voyant passer, couvrent leur visage d'un voile blanc, seul signe de deuil. Les portes du temple s'ouvrent et la morte est couchée sur un lit d'herbe séchée au pied de l'autel jusqu'à la tombée de la nuit. Les prêtresses préparent la morte pour sa longue traversée. Elles la revêtent de la large robe qu'elle avait tissé pour le jour des ses noces.
A la tombée de la nuit, le fils, ou le plus souvent le petit-fils de la défunte, surgit dans le village. Hormis le temps des épousailles, c'est l'unique jour où un homme a le droit de franchir l'enceinte. Il soulève le corps dans ses bras, comme celui d'une épousée, et précède la procession de femmes qui serpente jusqu'au fleuve. Il dépose le corps dans une barque noire. Une prêtresse esquisse un geste de bénédiction et couche aux côtés de la vieille le diptyque peint le jour de ses noces anciennes par le peintre des siècles.
La procession reste en prière jusqu'à ce que la barque, poussée dans le lit du fleuve, disparaisse. Le lendemain matin, la barque noire est amarrée de nouveau sur la berge fleurie sans que personne ne sache, ni cherche à savoir, qui l'a reconduite et qui l'a déchargée de son secret.
Au solstice d'été, les hommes descendent des montagnes, pleins de fureur et de chants puissants. Pour quelques jours, ils envahissent le village de leur vacarme, de leur langue fleurie. Toutes les femmes les accueillent comme une délivrance et reconnaissent les visages aimés. Les épousées se tiennent dans les ruelles à attendre leurs embrassements. Les enfants, en bandes désordonnées, les assaillent de leurs cris maladroits. A l'ombre des seuils, les jeunes filles à la voix fraîche restent à les regarder en retrait. Les jeunes gens, à la traîne des aînés, laissent passer le tumulte et attendent sur la place pavée qu'on leur apporte des boissons fraîches et des galettes dorées. Les jeunes filles s'affairent autour d'eux et laissent flotter leurs robes contre les jambes nues des jeunes gens. Les yeux se cherchent, les mains se frôlent.
Toute la nuit, le village est en fête. Les jeunes filles sont tenues à l'écart. Les épousées du dernier an veillent à ce que personne ne manque ni de nourriture, ni de boissons. A la nuit tombée, les hommes mariés rejoignent leurs maisonnées. Les autres s'endorment dans la vaste maison des hôtes. La coutume veut que les jeunes gens passent la nuit d'avant leur mariage dans le lit des veuves encore en âge. Le village s'endort sous les rires, les râles et les frémissements.
Quand le soleil se lève, les prêtresses annoncent le jour béni des épousailles venues. Le peintre des siècles, arrivé de la plaine, installe ses couleurs éclatantes au centre de la place et dispose les panneaux de bois.
Cette année, trois jeunes filles ont revêtu les robes de noce. Jusqu'au champ sacré, elles s'avancent, suivies des villageois. Autour de l'autel de plein air, tous prient ou discourent sur les saisons et les souvenirs. Les jeunes filles attendent leurs promis qui sont les derniers à pénétrer le cercle sacré. La cérémonie débute dans les chants et l'allégresse.
Une fois par an, les hommes du village s'unissent à leurs épouses. Une fois par an, le village sort de la monotonie des jours. Tout le reste de l'année, les jours et les siècles ont le même éclat. Le village, comme endormi, chevauche le coursier du temps immobile.
Cette histoire m'a été contée au cours de l'été 1994, par une chamane qui habite près du mont Khangaï, à l'ouest de la Mongolie. Je n'ai jamais découvert le chemin qui mène à l'entrée de ce village.
 votre commentaire
votre commentaire Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
Nuits blanches
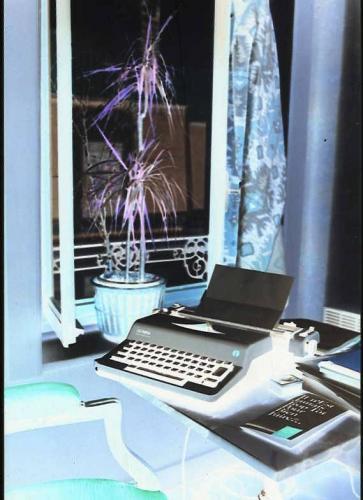
 Twitter
Twitter del.icio.us
del.icio.us Facebook
Facebook Digg
Digg Technorati
Technorati Yahoo!
Yahoo! Stumbleupon
Stumbleupon Google
Google Blogmarks
Blogmarks Ask
Ask Slashdot
Slashdot



