-

Le soir allait tomber, je t'attendais au pied de la véranda. Mon exil allait prendre fin. Dans l'allée de graviers, tu approchais. Droit, élancé, tu ressemblais toujours à nos peupliers qui se courbaient à ton passage et murmuraient pour t'accueillir. Tu te penchas pour me saluer. Est-ce que tu m'embrassas ? Est-ce que tu me serras comme un frôlement pour nos retrouvailles ? Je reconnus ta démarche, je reconnus ta voix, je retrouvai ton regard. Nous nous sommes assis sur la terrasse, en surplomb du lac. Il faisait frais. Nous écoutions les grands peupliers trembler dans le jardin, je frissonnai, ce n'était pas seulement le vent qui s'était levé. De quoi avons-nous parlé au juste ? Je parlais de moi, tu parlais de toi ? Entrecoupé de silences. Je compris que tu avais pris une de tes drogues. Je fumais tes cigarettes. Des Craven comme dans la chanson. Je savais que tu n'avais pas toute ta raison, et la mienne chancelait.
 votre commentaire
votre commentaire
-

Lorsqu'en février, je t'avais croisé dans ce train, j'avais d'abord aperçu une femme aux cheveux roux, vêtue d'une robe noire. Son menton et son nez parfaits glissaient dans son visage mobile et gai. Sa bouche maquillée lui donnait un air gourmand. Ses mains la trahissaient, tes mains te trahissaient. Tu ne parvenais pas à me tromper. Je t'avais reconnu. Là, face à moi, celui qui avait été mon jeune époux s'était transformé en une créature féminine qui rivalisait avec mes propres charmes.
Dans la véranda, cette femme qui lui ressemblait, et qui était toi, posait un baiser sur les bords de ma bouche. Je découvrais ton nouveau corps, je goûtais à un désir impensable, je touchais à tes blessures masquées par tes nouvelles cicatrices. Tu avais un corps de femme, je ne l'étais plus. Renverser les rôles, céder à tes désirs féminins. Je devenais à mon tour homme : je te dévisageais comme une belle chose. Mes raisons harcelantes se laissaient désarmer. L'idée de l'amour m'emplissait sans que j'aie à rougir de mes désirs, oubliant tes ambiguïtés, tes travestissements, tes abandons à d'autres corps, plus masculins. Que ton enveloppe mortelle fût celle d'une femme ou d'un homme m'importait peu. Au fond de moi, c'était ton âme que je respirais. Longtemps j'avais senti la mienne se morceler et ton retour la ressuscitait. Tu étais revenu, nous avions retrouvé le chemin.
J'étais avec toi ce soir pour tous les soirs d'hier et de demain. J'étais avec toi depuis si longtemps, dans tes mystères, dans tes profondeurs, dans tes identités. Depuis ce premier regard dans le café français, je t'appartenais. Depuis notre première nuit dans la chambre rouge, je t'appartenais. J'étais liée à toi par les fils de tes destinées. Je ne cherchais pas à savoir quelle rive tu tentais d'atteindre avec ton nouveau corps. Dans tes détours, c'étaient les mêmes contours de toi à moi que nous dessinions. Nous éloignions de nous l'angoisse crépusculaire. Corps jumeaux enfin retrouvés pour l'unisson. Tu as murmuré : « Laissons-nous surprendre par la tentation, rendons-nous à l'amour. »à suivre
Illustration : Compartiment C, voiture 193. Edward Hopper. 1938
 1 commentaire
1 commentaire
-

En cette fin d'après-midi d'automne, les rayons rasants du soleil éclairent la véranda. Derrière ses vitres embuées, j'entends les corbeaux croasser aux cimes des peupliers dénudés. Derrière moi, tu te tiens assise à la table d'écriture. Je songe à Orphée et à Eurydice. Je me retourne et ne crains pas de te regarder. Ton visage est tendu, ta bouche esquisse comme un chuchotement, tente-t-elle de raconter tes souffrances ambiguës ? Je n'entends que la pointe de ton stylo qui court sur le papier. Tu poursuis inlassablement tes écritures, derniers barrages contre l'effroi. Je t'offre une tasse de café. Lorsque le soir nous rejoint, nous regardons la lune se lever, fragile sentinelle qui veille. Je suis envahie par une certitude : nous vieillirons ensemble. Comment tout cela a-t-il commencé ? Au cours d'un voyage en train, par un frileux matin de février.
Fin
Photo : Yves-Marie Jacob
 1 commentaire
1 commentaire
-
Je me suis inventée un père : il s'appelle Kazantzákis. Pourquoi dès que j'ouvre ses livres, les yeux me brûlent-ils ? Je ne suis pas une enfant de Crète. A Naxos, les prêtres catholiques ont fermé leur école. Il n'y a plus de jardins et les tavernes sont remplies de touristes. Pourquoi alors me tourmentes-tu au-delà tu temps ? Le soleil brillant lentement retourne à l'horizon. Il inonde encore la mer qui scintille, frileuse, annonçant déjà la nuit. Et moi, je pleure, parce que mon cœur déborde d'élan. Est-ce lui qui m'appelle, le Crétois, ou bien est-ce moi qui l'appelle ? Qui peut le dire ? J'ai hésité avant d'acheter « Lettre au Greco ». Je savais bien qu'en lisant le titre de loin, faisant semblant de ne pas le voir, qu’une fois encore Kazantzákis me posséderait. J'avais peur, tous ces mots qu'il crie à la face du monde. La Crète, terre rouge, terre de révolte, est son alibi. Comment retenir les larmes qui jaillissent comme la source, qui me tiennent dans leurs serres. Je me livre à l'aigle, telle l'hirondelle et accepte de gravir le mont du Golgotha à mon tour. Une femme le peut-elle ? Je voudrais le repos. Une main puissante me prend l'épaule et de force me montre Apollon brillant jusqu'à m'aveugler. Depuis que les mains rouges ont imprimé les cavernes de Lascaux, depuis que le potier a tracé à l'encre noire le premier profil du dieu, la lutte a commencé. L'homme s'élève au-dessus de la Terre, il soulève son regard et tous les jours brûle au soleil, souffre au vent. Il résiste, il refuse, mais la route continue. Toujours la vie se moque et l’entraîne sur sa pente tragique. Que croit-il gravir ? Quels monts pourraient le contenter ? Qu’elle soit sacrée ou magique, aucune montagne ne viendra à bout de son orgueil. Eh quoi ! Il croit se soulever davantage en portant d'immenses croix là-haut ? Foutaises ! La vie s'en moque. Sa route va tout droit quand celle de l'homme se perd. La vie vogue bien haut et rit des culbutes de l'humanité. Pas même, elle ne les voit pas. Elle n'a pas le temps.
Mon dieu, l'alouette qui plonge dans son nid a-t-elle deviné que l'aigle moqueur guette ses petits ? A-t-elle deviné qu'elle s'épuise pour rien à les nourrir ? Elle tourne la tête et son œil luisant pourrait te sourire. Bien sûr, elle sait tout cela, mais elle continue son vol, d'un trait. Qui lui permettrait de se détourner ? Et même, l’aigle ne sera peut-être pas si gourmand ? Un oisillon sera épargné. Il faut poursuivre. L'alouette plonge dans le nid et du bec nourrit ses petits. Si ceux-là meurent, d'autres viendront. Elle reprendra ses vols.
Allons toujours, il faut chercher dans la voûte bleue des réponses qui n'existent pas. Nous avons beau grimper les plus hauts sommets, aucune réponse ne teintera à nos oreilles. Le silence seul s’abat sur nous comme le rire perlée des sirènes.
Voilà, il m'a encore sauté à la figure ou bien est-ce l'ouzo qui me tourne la tête ? Kazantzákis est un démon. A peine deux pages lues et déjà je fonds. Je retiens mes larmes comme des aveux ridicules.
Un homme véritable ne se retourne pas pour dire adieu à ses père et mère, nous rappelle Kazantzákis . Alors je n'avais pas à me retourner quand ma mère a jeté son dernier souffle. Elle est partie sans que j'ai pu voir ou deviner son adieu. Elle m'a laissée sur le chemin sans appui. J’ai la faiblesse de croire que les nuits, en étoile brillante, elle revient parfois pour nous lier encore. Et souvent je lève les yeux vers la voûte marine pour chercher son secours ou pour la remercier. A la fois solitaire et jamais abandonnée jamais je ne pourrai lui dire : « Mère, pourquoi m'as-tu abandonnée ? » Si la blessure de sa cuisse l'a vidée silencieusement de son sang, jamais elle n'a réussi à la vider de moi. Plus faible et plus forte, l'orpheline avance parmi les hommes avec au-dessus de la tête, la petite sirène étoilée qui veille sur elle.
Comment l'humanité, pleine de souffrances, guidée par la « constellation de l'angoisse », comme la nomme Kazantzákis , pourrait-elle parvenir à l'union des contraires ? Il faudrait plus d'amour et moins de haine. Plus de générosité et moins d'orgueil.
Post scriptum Níkos Kazantzákis (en grec moderne : Νίκος Καζαντζάκης) ou Kazantzaki ou encore Kazantsakis, né le 18 février 1883 à Héraklion, en Crète, et mort le 26 octobre 1957 à Fribourg-en-Brisgau (Allemagne). votre commentaire
votre commentaire
-
Pourquoi me hissai-je dans ce trou,
Impressionnant cachot qui m’oppresse,
Infini tunnel rempli de fous
Qui me frôlent, me touchent, me pressent ?
Sans cesse, des marches se déroulent
Etranges serpents morts qui étranglent
L’unique issue loin de cette foule
Qui surgit, ricanante, à tout angle.
Soudain une froide nuit embrasse
Mon corps. Et ma prison sans barreaux
Se resserre sur mon âme lasse,
Blessée par un injuste bourreau.
Sa lâche mission est de masquer
A mes yeux voilés la lumière
De l’ailleurs, faible lueur traquée
Par cet être aux gestes de pierre.
Mon cœur éprouvé je sens fléchir,
L’espoir le délaisse et naît la peur
Je cherche à fuir ce songe, à franchir
La frontière qui mène au bonheur. votre commentaire
votre commentaire
Nuits blanches
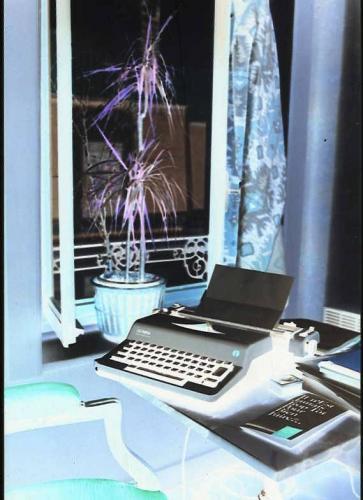
 Twitter
Twitter del.icio.us
del.icio.us Facebook
Facebook Digg
Digg Technorati
Technorati Yahoo!
Yahoo! Stumbleupon
Stumbleupon Google
Google Blogmarks
Blogmarks Ask
Ask Slashdot
Slashdot




