-
Par Corinne Valleggia le 11 Juillet 2013 à 23:50

J'avançais dans le sous-bois. Je n'avais jamais su distinguer l'odeur des mousses et des herbes médicinales. J'avais passé ma vie dans les villes et je connaissais bien mieux les parfums artificiels des courtisanes et celui, âpre et tout aussi envoûtant, des eaux boueuses du fleuve. Le fleuve, je venais de le quitter. Abandonnant la route empruntée par les voitures à bœufs et les paysans qui allaient charger dans les barques plates leurs sacs de grains, je marchais dans les sentiers, sous les feuillus, longeant le flanc des monts.
Encore une heure de marche et je rejoindrais la maison du lac. J'avais demandé à mes gens d'attendre le lendemain pour monter mes bagages. Je voulais surprendre ma vieille amie. Personne ne l'avait prévenue de mon arrivée et je riais à demi, comme un jeune amoureux, si bien que je rougissais et tendais l'oreille de crainte qu'un voyeur ne surprît mes radotages. Car enfin mes cheveux étaient blancs, mes yeux plissaient en rides infernales, mes mains tremblaient et ce n'était pas de désir mais bien de vieillesse. J'avais pris la précaution de tailler un bâton dans la branche noueuse d'un noyer pour aider mes pas. Bien que le voyeur eût pu à coup sûr reconnaître les marques de l'implacable vieillesse, je n'étais pas très sûr moi-même qu'elle régnât désormais : l'air embaumait tout autant que dans ma prime jeunesse et mon cœur battait tout aussi fort, quoique ce ne fut pas seulement d'un tendre épanchement. Surtout, ma tête s'emplissait de sourires émerveillés pour peu que le ciel ait surgi entre les feuillages denses ou qu'un oiseau, dérangé à mon passage, s'envolât d'un coup, lançant son cri charmant. Il faisait chaud malgré septembre. J'épongeais mon front avec la large manche en soie de ma tunique. « Maître, vous ne devriez pas quitter votre fonction, que ferez-vous si vous renoncez à marchander sur le fleuve ? » J'avais ri en hochant la tête, sans répondre à la question naïve de mon assistant. Depuis plusieurs mois, j'avais cédé à d'autres marchands mes bateaux à voile, l'un après l'autre. J'avais goûté tous les délices de ce monde de marchands et il ne restait au bord de mes lèvres qu'une fadeur flétrie. Mes maîtres et les ancêtres avaient obtenu de moi ce qu'ils attendaient : raison, fortune et descendance. Je pouvais m'appartenir. A l'aube de ma vieillesse, j'avais enfin renoncé. La première étape était cette visite.
Je repris mon chemin. A l'ombre rouge des mûriers, j'entrevis la terrasse en bois qui avançait son promontoire laqué jusque dans les eaux du lac. Le clapotis se mêlait à des voix de femmes. Elles étaient cinq, à marcher, à s'asseoir, près de la maison du lac. Trois se tenaient debout auprès d'une balance à levier, à peser des boules de jade. Les deux autres étaient assises et je reconnus Wen k'i. Elle écoutait une jeune lectrice lui lire des poèmes anciens. On entendit les cloches du monastère dans le lointain. Wen k'i se leva à ce moment et me reconnut. A chaque rencontre, je tremblais en découvrant sa silhouette. Tout comme le lac aux eaux trop calmes, Wen k'i, visage serein et sourire doux, m'avait longtemps inquiété. Elle avançait jusqu'à moi, flottant dans ses vêtements amples, rouge brun, aux accents de sa bouche.
Les émotions revenaient comme en ce temps où je la découvris, étendue dans les coussins en satin de soie de la maison des courtisanes. Ce jour-là, elle jouait avec un chat qui mordillait ses bras nus sans qu'elle n'osât le gronder bien que les larmes lui vinrent aux yeux. La patronne retira le maléfique animal, craignant pour la beauté de sa protégée. Les mains gracieuses de Wen k'i se refermèrent sur le vide, regrettant la boule douce et cruelle qui avait veiné de marques rouges ses bras graciles. Je pénétrais pour la première fois dans la maison des courtisanes, lieu réservé aux hommes fortunés, accompagné de mon oncle qui avait décidé de compléter l'éducation paternelle trop stricte à son avis, en me dévoyant à ses propres vices. De disciple docile, je devins vite aussi peu vertueux que lui et j'aurais bien passé toutes mes nuits dans ce lieu. L'odeur qui régnait là surtout m'entêtait. Tout le jour, les plis de mes vêtements la conservaient et me rappelaient à lui. Ma peau se chargeait des douceurs de la veille et se souvenait des corps lisses réservés aux caresses, préservés des tempêtes du dehors. Mon oncle fréquentait le lieu interdit le plus somptueux de la ville. Nous retrouvions dans le grand salon les marchands et les notables et parfois de riches étudiants qui n'en finissaient plus d'accumuler les années d'études et les nuits de débauche. Dans cette pièce soyeuse, embrumée par l'opium que quelques uns goûtaient sans excès, les conversations croisaient les parfums et les gestes tendres. De temps en temps un couple se dirigeait vers les chambres, séparées du grand salon par un jardin d'hiver. La patronne veillait à la réputation de sa maison et ne tolérait aucun geste déplacé en présence de ses invités, comme elle nous appelait. Elle s'emblait ignorer pour quoi nous étions là et le monde des chambres lui était étranger.
Dans le salon d'apparat, dès notre arrivée, Wen k'i s'était blottie contre mon oncle. Ses yeux avaient croisé les miens. A peine. Ce n'était pas certain. Chaque jour, ou presque, je me mis à fréquenter la maison des courtisanes. Les conversations rappelaient celles des clubs britanniques que j'avais fréquentés lors d'un bref séjour à Hong Kong. Ici, la présence des femmes adoucissait l'âpreté des propos, nous en mesurions leur fugacité.
à suivre... votre commentaire
votre commentaire
-
Par Corinne Valleggia le 9 Avril 2007 à 20:07
Courtisane - suite 4
Wen-K'i se leva sans bruit, ouvrit la porte de la véranda. Le lac, au petit matin, s'estompait sous les brumes blanches. Silence. Suspension. Les arbres frileux plongeaient leurs chevelures rousses dans les eaux arrêtées. Le châle de Wen-K'i ne suffisait pas à la réchauffer et elle goûtait au froid du matin comme elle avait jadis goûté aux blessures de l'amour. Une main serra son coude. Je l'avais vue, tremblante, se pencher au-dessus de la balustrade, sans bruit, je m'étais approché, vibrant à ses pensées. Nos yeux étaient sans mélancolie, sans regret, sans espoir non plus. Nous attendions le moment où les existences glissaient, où la vie apparaissait en ultime vainqueur. Il y a longtemps, nous aurions pu nous comporter en maîtres des jours et des nuits. Ce matin d'automne, nous nous dressions au-dessus des eaux endormies et nous réalisions, après tant d'années, que le vertige nous avait toujours habités. Sans que nous ayons besoin de parler, nous savions, l'un et l'autre, que notre route aboutissait à ce même plan, douloureusement insensé, et qu'au même instant nos pensées renonçaient. Nous nous tenions debout, surplombant le lac, ma main pressant le coude de Wen-K'i.
Une servante nous aperçut. Je lâchais le bras de Wen-k'i. Elle porta une table basse sous le prunier et nous servit du thé. Elle s'éloigna aussi vite qu'elle avait fait tous ces gestes. Nous demeurions, seuls, sur la terrasse, les brumes se dissipaient et la lumière chassait le fond de la nuit. Nous nous taisions. Je pensais que demain je partirais. Je savais que derrière les monts de la Belle Endormie se nichait un ermitage où vivait un vieil homme. Une ferme entourée d'un jardin était abandonnée près de là. J'y resterais le temps qu'il conviendrait à lire et à écrire. C'était ce que je finis par expliquer à Wen-K'i, d'un air détaché et persuasif. Elle sourit et avoua que le pavillon du lac était en quelque sorte sa ferme. Bientôt, elle y resterait seule, elle aussi, avec ses servantes, renonçant à recevoir quiconque. Elle rectifia : ce n'était pas un renoncement. Ses désirs, qui l'avaient protégée jusque là, s'effaceraient et un apaisement nouveau s'installerait. Elle n'en était pas encore très sûre mais elle le sentait.
Les jeunes filles se levèrent et l'une d'elles plongea nue dans le lac. Elle nagea calmement et bientôt se hissa de nouveau sur le ponton de la terrasse. Le jeune homme qui sortait de la chambre de Wen-K'i s'approcha et l'enveloppa pour la sécher dans un linge blanc. Ils riaient tous les deux, oublieux. Lorsque Wen-K'i porta à ses lèvres la tasse de thé, je remarquai une ride nouvelle au coin de sa bouche. Sur la Belle Endormie, les cyprès et les pins fixaient le monde dans une pause éternelle et contemplative. Demain, je serais là-bas. J'ai oublié ce que fut le reste de la journée : la peau douce comme le jade de Wen-K'i, le parfum de ses cheveux et la hardiesse de sa nuque. Rien d'autre n'avait d'importance.
Le matin de mon départ, Wen-K'i m'avait tendu un rouleau calligraphié retenu par un lien de soie : « Tu le liras lorsque tu seras arrivé dans ton monastère. » J'attendis trois soirs avant de me décider à dénouer le lien. Je tentai de calmer mes émotions en faisant brûler de l'encens. Je déroulai lentement le rouleau, retenant encore l'instant de la découverte. Je commençai ma lecture. « A mon aimé». Je me souvins d'une question qu'elle m'avait posée il y avait bien longtemps : « As-tu déjà livré toute ton âme à quelqu'un ? » Je n'avais pas su répondre. Avec ses textes, calligraphiés de sa main, Wen-K'i me livrait toute son âme.
Depuis, je vis dans cette ferme au bord d'un plateau enlacé aux monts de la Belle Endormie. Je contemple le paysage, le vide empli de ce décor. Peut-être une vieille Chinoise fardée se penche-t-elle encore sur le miroir du lac, celui-là même qui a emporté son dernier amant. Le jeune homme aux cheveux courts, debout dans la barque, venait d'enlever la nièce adorée aux longs cheveux de soie. La vieille courtisane dormait dans sa chambre close quand les jeunes gens se sont éloignés, silencieux et criant dans leur tête des mots insensés, des aveux spontanés. N'était-ce pas d'ailleurs le battement strident de leur trahison qui l'avait éveillée ? Elle sétait glissée sur la natte, avait tiré la baie opaque et là-bas, sur le miroir gris, la barque les emportait au loin. Wen-K'i n'avait pas gémi. Sa vieillesse, en rides arrondies, pareilles aux vagues frangées sur le lac, apprivoisait ce sentiment étrange : le renoncement que certains nomment sagesse. Aux portes de la vie, aux dernières bornes, elle allongeait le bras pour dessiner dans le vide de l'air -pas tout à fait le vide- le visage de son aimé.
Retournerai-je un jour à la maison du lac ?
Fin à écouter sur Bonnes Nouvelles : http://www.bonnesnouvelles.net/ votre commentaire
votre commentaire
-
Par Corinne Valleggia le 9 Avril 2007 à 10:20
Courtisane - suite 3
Lors de mon arrivée impromptue, ce matin d'automne, Wen-K'i resta silencieuse. Tant d'années avaient passé sans que nous ayons pu, ou voulu, nous revoir. En me retrouvant, elle replongeait dans des temps, des lieux, des circonstances qui avaient construit sa mémoire. Elle intériorisait tous les moments anciens de sa vie, traversait sa jeunesse comme le passant franchit le fleuve en marchant sur l'arche d'un pont. Elle me voyait très loin sur l'autre rivage de sa vie. J'inventais, pour la vieille dame qu'elle devenait, des histoires sur le soleil, le fleuve bleu, l'ancienne maison des courtisanes pour tenter de déchirer son silence troublant. Le soir allait tomber quand un groupe de jeunes gens rejoignit le pavillon. Deux jeunes filles approchaient, habillées à la mode Song, en jupe longue et veste croisée courte. De loin, ces deux jeunes filles -l'une d'elle était la nièce de Wen-K'i- rappelaient les fées de jadis. Wen-K'i aurait été leur mère. Leur cou vierge brillait sous le soleil descendant. Un jeune homme les suivait, en pantalon retombant sur ses chausses. Il avançait sans bruit, n'écoutait pas leurs discours ponctués de rires. Il baissait les yeux mais près de Wen-K'i, ses paupières lourdes battirent et, noir, son regard frappa celui de Wen-k'i, immobile et pâle. La soirée passa sur la terrasse, face au lac aux couleurs changeantes, le grand miroir des plaisirs comme Wen-K'i l'avait surnommé. Wen-K'i et le jeune homme parlaient à peine. Je me joignis à l'insouciance des jeunes filles qui racontaient dans le détail leur journée de baignade. Je leur contais les histoires du fleuve et de la ville. La nuit et ses étoiles s'installèrent tout à fait au-dessus du lac. Les vagues restaient blanches sous l'éclairage des lampions mais frappées de noirceur dans les profondeurs. Le thé embaumait quand les servantes le servirent une dernière fois. Les jeunes filles se turent. Nous nous retirèrent tous. Wen-K'i prit la main du jeune homme qui la suivit dans leur chambre. Dans quelques instants, ils reposeraient sur la même couche. La nuit apaisante les entraînerait dans les mondes liquides du plaisir. Je me représentais le jeune homme dans le lit de Wen-K'i. Avait-il vingt ans ? Ses cheveux noirs étaient coupés courts. Sur le bord de mon lit, je balançais mon corps à jamais renonçant.
Je me réveillais à l'aube. L'aube. Le lac était laiteux, liquoreux à m'écœurer. J'irais demain dans les montagnes, à l'abri des incertitudes des berges. Uniquement le ciel à portée de main. Dans sa chambre, Wen-K'i s'éveillait et elle tendait son bras vers la place du jeune homme. Ce geste la rassurait -elle était encore capable d'émotions- et l'inquiétait -jusqu'à quand s'endormirait-il près d'elle ? Longtemps avant cette nuit, ou peut-être était-ce hier, le jeune homme étendait son bras au petit jour pour la caresser. Elle blottissait alors son corps chaud contre le sien mais elle gardait la tête en creux dans les rêves. Ce matin, le jeune homme aux traits lisses s'étendait dans son sommeil insensible aux gestes de Wen-K'i. Sa main à elle effleurait son épaule, s'arrêta un instant sur sa chevelure, se retint et se referma sur le vide. La vie affirmait son pouvoir, les emprisonnait l'un dans sa jeunesse, l'autre dans la courbure de sa vieillesse. Wen-K'i tâtait son visage. Depuis quelques mois, elle répétait sa découverte : le visage amolli, tiraillé de rides fines, le ventre affaibli. Tout cela avait-il encore de l'importance ? Le jeune homme partirait et ce serait la dernière passion. Elle avait murmuré ce mot pour lui donner corps. Le jour, ils parlaient l'un près de l'autre, pressaient leurs lèvres, leurs promenades étaient des prétextes à des mouvements amoureux. Pourtant leurs regards ne s'arrêtaient jamais dans le regard de l'autre, leurs mains ne tremblaient pas tout à fait et leurs bouches cassaient leurs aveux. L'impossible planait sur leur rencontre et la passion de leurs corps ne parvenait pas à briser l'interdit. Depuis vingt ans, depuis son arrivée au lac, Wen-K'i répétait la même impossible rencontre. Elle ne savait pas qu'elle cherchait à travers ces jeunes hommes celui qu'elle avait connu une nuit dans la maison des courtisanes. Je ne le savais pas non plus.
à suivre votre commentaire
votre commentaire
-
Par Corinne Valleggia le 8 Avril 2007 à 17:30
Je me souvenais de l'entrée du restaurant Jen. Derrière, on se retrouvait dans un long corridor bordé de loggias. C'était là que se cachait la maison des courtisanes. Le soir, les lampes et les bougies scintillaient partout. Les filles maquillées, aux vêtements chamarrés, se penchaient à la balustrade près des avant-toits et attendaient d'être choisies par les clients. Dans ces nuits, l'alcool de riz épaississait nos propos, qui se voulaient logiques mas qui, dans ce lieu, étaient absurdes, indécents. Wen-K'i, que mon oncle tenait par la taille, balançait son corps au son de la musique. Elle se moquait de nous et nous rappelait que nous délirions bien plus dans le flot de nos paroles que dans les couches humides. J'oubliais un instant ce qui m'entraînait si souvent dans ce lieu, je reculais l'instant de la volupté partagée avec d'autres corps que le sien.
Un jour d'hiver, mon oncle tomba malade. Rien de grave, mais il fut alité toute une semaine. Dans la journée, je faisais prendre de ses nouvelles. C'était un prétexte pour me rendre, le soir venu, à la maison de courtisanes et rencontrer Wen-K'i. Sur la loggia, elle tendit les mains et me parla sans que je l'entendisse tout à fait. Je lui parlais de la santé de mon oncle et je répondais au hasard à ses questions. Elle ne remarqua pas mon trouble ou feignit de l'ignorer. Nos rencontres avaient toujours revêtu cette réserve et bien que l'émotion fût présente, nous n'en parlions pas. Je repensais au poète : « Il n'y a là qu'une vérité mais en voulant la dire, j'en ai oublié les mots. » Je regardais Wen-K'i se courber pour cueillir une orchidée dans le jardin d'hiver et le mouvement de sa main flottait à l'infini, depuis le ciel jusqu'à la terre. La fleur pourtant était déjà coupée et la main la tenait. Wen-K'i m'avait toujours beaucoup parlé et peu écouté. Ce n'était pas qu'elle ne prêtât pas attention à mes paroles, mais naturellement, en sa présence, je parlais peu. Par ses paroles, Wen-k'i tissait un voile entre nous et moi, en oubliant les mots, j'épaississais ce voile. Nous avions involontairement créé les conditions pour ne jamais écouter nos désirs. Ce soir-là, Wen-K'i était une déesse. Diaphane, incertaine. Cette transparence venait plus du velouté de sa peau, que de sa chair. Les plis de sa robe accentuaient les formes pleines de son corps. Elle avait déchaussé ses sandales et j'admirais la courbure de son pied parfait, l'ombre des doigts, de la plante, posée là sur le sol. Cette nuit-là, ce sont nos corps qui tombèrent les premiers sur sa couche, nos âmes au loin se perdirent. Nous avons jeté des cris de désir et de désespoir au cœur des ténèbres. Jamais l'amour n'atteignit sa profondeur ailleurs qu'en ce lieu et ce temps interdits.
Mon oncle guérit vite et je m'empressais de quitter la ville, sur un de mes bateaux. Je décidais de naviguer dans les villes coloniales de la Mer de Chine, pour m'enrichir. Pour oublier. Lorsque je revins, Wen-K'i me reçut sans laisser paraître de trouble, sans me questionner. J'en conclus qu'elle avait oublié. Je disparus quelque temps de la maison des courtisanes. Lorsque j'y revins, j'étais marié, je me fréquentais par conséquent très rarement le lieu des plaisirs.
A la mort de mon oncle, Wen-K'i reçut en legs le pavillon du lac et une petite concession de sel. Elle décida de quitter la maison des courtisanes et de se retirer dans ce paysage minéral et aquatique. Elle avait trente ans. Durant quinze ans, elle avait vécu dans la maison des prostituées. Jamais son teint ne s'était fané et ses gestes, son attitude avaient conservé toute leur spontanéité. C'en était inconvenant à force d'innocence. Lorsqu'elle rejoignit la maison du lac, une petite cour l'accompagna depuis la ville pour fêter sa nouvelle vie. Chaque été, certains faisaient le pèlerinage jusqu'à elle. Je n'y venais qu'un seul été. Je lui annonçais la naissance de mon premier fils. Elle me regarda et je soupçon-nais une immense tristesse planer dans son regard qu'elle détourna tout aussitôt pour goûter au thé vert posé dans la tasse en porcelaine blanche sur le guéridon de la véranda. Je scrutai tous ses gestes et je compris bien plus tard que je l'avais blessée. J'oubliais Wen-K'i. Mes années de marchand, mes années d'époux et de père de famille, m'éloignaient d'elle. Il m'arrivait de voir son regard lorsque je me tenais assis dans un train qui me conduisait à Shanghai, de m'endormir en entendant sa voix me souhaiter le bonsoir, de sentir son odeur dans un jardin de Hangzou, d'oublier qui j'étais.
à suivre votre commentaire
votre commentaire
-
Par Corinne Valleggia le 6 Avril 2007 à 21:38

Courtisane
J'avançais dans le sous-bois. Je n'avais jamais su distinguer l'odeur des mousses et des herbes médicinales. J'avais passé ma vie dans les villes et je connaissais bien mieux les parfums artificiels des courtisanes et celui, âpre et tout aussi envoûtant, des eaux boueuses du fleuve. Le fleuve, je venais de le quitter, abandonnant la route empruntée par les voitures à bœufs et les paysans qui allaient charger dans les barques plates leurs sacs de grains. Je marchais dans les sentiers sous les feuillus, longeant le flanc des monts.
Encore une heure de marche et je rejoindrais la maison du lac. J'avais demandé à mes gens d'attendre le lendemain pour monter mes bagages. Je voulais surprendre ma vieille amie. Personne ne l'avait prévenue de mon arrivée et je riais à demi, comme un jeune amoureux, si bien que je rougissais et tendais l'oreille de crainte qu'un voyeur ne surprît mes radotages. Car enfin mes cheveux étaient blancs, mes yeux plissaient en rides infernales, mes mains tremblaient et ce n'était pas de désir mais bien de vieillesse. J'avais pris la précaution de tailler un bâton dans la branche noueuse d'un noyer pour aider mes pas. Bien que le voyeur eût pu à coup sûr reconnaître les marques de l'implacable vieillesse, je n'étais pas très sûr moi-même qu'elle régnât désormais : l'air embaumait tout autant que dans ma prime jeunesse et mon cœur battait tout aussi fort, quoique ce ne fut pas seulement d'un tendre épanchement. Surtout, ma tête s'emplissait de sourires émerveillés pour peu que le ciel ait surgi entre les feuillages denses ou qu'un oiseau, dérangé à mon passage, s'envolât d'un coup, lançant son cri charmant. Il faisait chaud malgré septembre. J'épongeais mon front avec la large manche en soie de ma tunique. « Maître, vous ne devriez pas quitter votre fonction, que ferez-vous si vous renoncez à marchander sur le fleuve ? » J'avais ri en hochant la tête, sans répondre à la question naïve de mon assistant. Depuis plusieurs mois, j'avais cédé à d'autres marchands mes bateaux à voile, l'un après l'autre. J'avais goûté tous les délices de ce monde de marchands et il ne restait au bord de mes lèvres qu'une fadeur flétrie. Mes maîtres et les ancêtres avaient obtenu de moi ce qu'ils attendaient : raison, fortune et descendance. Je pouvais m'appartenir. A l'aube de ma vieillesse, j'avais enfin renoncé. La première étape était cette visite.
Le sous-bois s'éclaircissait et le chemin descendait en pente douce, bientôt j'apercevrais le lac aux reflets de jade. Voilà qu'il apparaissait déjà, son silence m'avait toujours surpris : il miroitait, morne comme la sagesse -avais-je pensé dans ma jeunesse. Il inquiétait le passant que j'étais, en cet endroit surtout où la berge tombait tout en roches et en terre noires. Une brume rose s'élevait en cette fin d'après-midi et adoucissait les contours rugueux, brouillait les herbages de la prairie qui descendait jusqu'à l'autre rive, plus apaisante où la maison était posée. Le chemin d'ailleurs se perdait dans les herbes grasses et je craignais de glisser dans cette terre trop riche. Je m'arrêtais un instant, pour reprendre mon souffle et mon équilibre -prétextant que je voulais contempler ce paysage ombré. Au loin, deux traits bruns étaient en mouvement : un buffle d'eau tirait une herse, guidé par un enfant. J'avais l'esprit serein, le cœur heureux, je n'espérais rien, même la mort n'était plus une inquiétude et vieillir était devenu une habitude après avoir été une idée embarrassante.
Je repris mon chemin. A l'ombre rouge des mûriers, j'entrevis la terrasse en bois qui avançait son promontoire laqué jusque dans les eaux du lac. Le clapotis se mêlait à des voix de femmes. Elles étaient cinq, à marcher, à s'asseoir, près de la maison du lac. Trois se tenaient debout auprès d'une balance à levier, à peser des boules de jade. Les deux autres étaient assises et je reconnus Wen k'i. Elle écoutait une jeune lectrice lui lire des poèmes anciens. On entendit les cloches du monastère dans le lointain. Wen k'i se leva à ce moment et me reconnut. A chaque rencontre, je tremblais en découvrant sa silhouette. Tout comme le lac aux eaux trop calmes, Wen k'i, visage serein et sourire doux, m'avait longtemps inquiété. Elle avançait jusqu'à moi, flottant dans ses vêtements amples, rouge brun, aux accents de sa bouche.Les émotions revenaient comme en ce temps où je la découvris, étendue dans les coussins en satin de soie de la maison des courtisanes. Ce jour-là, elle jouait avec un chat qui mordillait ses bras nus sans qu'elle n'osât le gronder bien que les larmes lui vinrent aux yeux. La patronne retira le maléfique animal, craignant pour la beauté de sa protégée. Les mains gracieuses de Wen k'i se refermèrent sur le vide, regrettant la boule douce et cruelle qui avait veiné de marques rouges ses bras graciles. Je pénétrais pour la première fois dans la maison des courtisanes, lieu réservé aux hommes fortunés, accompagné de mon oncle qui avait décidé de compléter l'éducation paternelle trop stricte à son avis, en me dévoyant à ses propres vices. De disciple docile, je devins vite aussi peu vertueux que lui et j'aurais bien passé toutes mes nuits dans ce lieu. L'odeur qui régnait là surtout m'entêtait. Tout le jour, les plis de mes vêtements la conservaient et me rappelaient à lui. Ma peau se chargeait des douceurs de la veille et se souvenait des corps lisses réservés aux caresses, préservés des tempêtes du dehors. Mon oncle fréquentait le lieu interdit le plus somptueux de la ville. Nous retrouvions dans le grand salon les marchands et les notables et parfois de riches étudiants qui n'en finissaient plus d'accumuler les années d'études et les nuits de débauche. Dans cette pièce soyeuse, embrumée par l'opium que quelques uns goûtaient sans excès, les conversations croisaient les parfums et les gestes tendres. De temps en temps un couple se dirigeait vers les chambres, séparées du grand salon par un jardin d'hiver. La patronne veillait à la réputation de sa maison et ne tolérait aucun geste déplacé en présence de ses invités, comme elle nous appelait. Elle s'emblait ignorer pour quoi nous étions là et le monde des chambres lui était étranger.
Dans le salon d'apparat, dès notre arrivée, Wen k'i s'était blottie contre mon oncle. Ses yeux avaient croisé les miens. A peine. Ce n'était pas certain. Chaque jour, ou presque, je me mis à fréquenter la maison des courtisanes. Les conversations rappelaient celles des clubs britanniques que j'avais fréquentés lors d'un bref séjour à Hong Kong. Ici, la présence des femmes adoucissait l'âpreté des propos, nous en mesurions leur fugacité.
à suivre...
Photos : Yves-Marie JACOB votre commentaire
votre commentaire Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
Nuits blanches
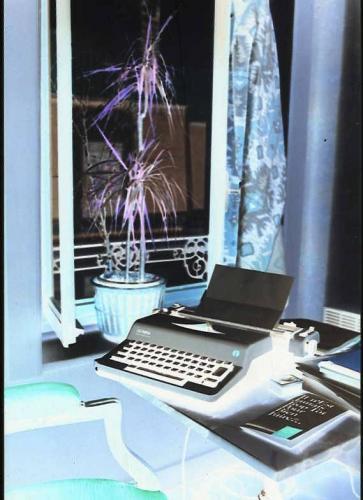
 Twitter
Twitter del.icio.us
del.icio.us Facebook
Facebook Digg
Digg Technorati
Technorati Yahoo!
Yahoo! Stumbleupon
Stumbleupon Google
Google Blogmarks
Blogmarks Ask
Ask Slashdot
Slashdot