-
Le sculpteur était venu de la cité côtière, quelques jours précédant les vendanges à la demande du prêtre. Mon père, m'avait-on dit, était allé l'attendre au croisement des chemins et l'avait conduit chez nous. Tous les jours, à l'heure du lever, il montait au temple où je l'attendais, assise dans cette même posture. Cet étranger partageait le repas de mes parents, de mes frères. Il saluait mon grand-père, couchait dans la pièce du nord, la plus fraîche à cette époque de l'année tandis que moi, en un temps parallèle, j'étais servie par mes servantes dans l'enceinte du temple blanc. La blancheur. Tout devait être blanc dans ce lieu consacré. Les murs blanchis à la chaux, les chèvres immaculées, jusques aux chiens au pelage laiteux qui gardaient les moutons, dans les prés et qu'on admettait parfois le soir dans la cour. Un chat, qui avait installé son repère à l'abri des murs sacrés, avait eu le tact de porter une fourrure opaline et se promenait à son aise jusqu'à ma chambre isolée, depuis que j'avais pleuré parce qu'on voulait le faire fuir. Ses caresses étaient la seule fantaisie qu'admettait le prêtre, non sans s'interroger : les lois prévoyaient-elles une telle promiscuité ? Le sculpteur bougea la tête vers moi et je refermais les yeux.
Je revoyais ce jour où, le prêtre s'était avancé jusqu'à moi, encore une enfant, dans la salle qui servait d'école. J'étais assise sur un banc et tenait sur mes genoux un boulier en bois. Le maître nous apprenait à compter, à moi et à d'autre enfants. Un peu à l'écart, j'écoutais et reproduisais les mêmes gestes que lui, faisant rouler une à une les boules dans leur cadre en buis. Le prêtre se tint debout devant moi, les mains jointes sur sa robe en lin épais. Il avait esquissé un seul geste auprès du maître qui avait balbutié des excuses et avait entraîné avec lui les autres enfants qui me regardaient sans comprendre. Je levais mes yeux noirs, cernés, sur son visage soucieux et impassible, qui semblait dire : « je te pardonne, tu n'es qu'une enfant » sans que je sache très bien quel mal j'avais commis. Ma mère entra avec précipitation et parla de grand-père puis me prit la main et je ne retournai plus jamais à l'école.
Au bord de la rivière, mon grand-père m'expliquait la forme des poissons et leur donnait à chacun un nom. Depuis que le prêtre avait défendu ma présence à l'école, je passais mes journées avec lui. Il avait prétexté sa démarche difficile pour que je puisse le suivre partout autour du village. Un jour, il s'écria : « Puisqu'on te refuse toute connaissance, au moins tu auras celle-là. », et d'un geste circulaire, il avait désigné tous les champs d'oliviers et plus loin les montagnes bleues. Chaque jour, il m'apprenait le nom des fleurs, des arbres. Je devais chaque fois les toucher, les sentir. En plein midi, nous restions à l'ombre d'un chêne, nous mangions quelques olives avec une galette plate. Venait l'heure de la sieste. Nous restions silencieux. Mon grand-père s'était mis en tête d'écouter les feuillages. Sagement, j'écoutais avec lui et nous n'entendions rien, que le bruit du vent feutrant les feuilles vertes. Dieu en son lointain demeurait. Je fermais les yeux pour rêver sans dormir. Les images se bousculaient sans que je puisse les retenir. Toujours, lorsque grand-père me sortait de cette rêverie, je sursautais : j'avais oublié l'ombre et la vallée calme.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p> </o:p>« Nous avons terminé pour aujourd'hui. » Il essuyait la lame du couteau et la rangeait dans son étui. Le marbre prenait des allures de déesse. Une servante, qui jusque là était adossée au mur, derrière moi, me couvrit d'un long châle. Le sculpteur, selon les convenances, s'approcha de moi et baisa le bout de mes doigts. Je sentais sa sueur. Un instant immobile, il me fixa et je soutins son regard. Il était plus grand que moi, légèrement. Son buste sembla se pencher en avant mais alors il lâcha ma main et sortit. Une servante, qui était restée tout le temps de la pause à tisser et à nous observer dans un coin de la pièce, lui ouvrit la porte. Le chant des cigales emplit la pièce et ma tête bourdonna longtemps. Maïs Expo photos de Lucien CLERGUE votre commentaire
votre commentaire
-
Grand-père m'a souvent raconté mon histoire. Avant même ma naissance, mon père avait dessiné mon sort sur le sol de notre maison en présence du prêtre. Ma mère se tenait près d'eux, sur un tabouret bas, elle arrondissait ses mains sur son ventre encore plat. Le prêtre traçait silencieusement les signes : le symbole de la fécondité et celui de la féminité. Ce soir-là, le ciel avait basculé dans la nuit si brusquement que les bêtes avaient grogné dans les étables. Après avoir goûté une soupe légère et du lait de brebis, le prêtre était reparti, s'appuyant sur son bâton noueux. Aucun mot, ou presque, n'avait été échangé. Mes frères, alors encore tout-petits, avaient suspendu leurs jeux et retenaient leurs jouets dans leur blouse salie. Puis ils s'étaient couchés à regret dans le coin de la maison qui était le leur. Ma mère avait éteint la lampe, puis elle s'était étendue sur la natte et s'était serré contre mon père sans que les garçons puissent les voir ou les entendre. Sur le seuil de la maison d'à-côté, mon grand-père avait salué brièvement le prêtre à son départ et sa bouche avait tenté de murmurer un assentiment. Surtout une lumière soudaine avait brillé dans ses yeux quand le soleil bascula derrière l'horizon, cette lumière que toujours j'ai aimée. Huit mois plus tard, au lever du soleil, ma mère tenait au-dessus du sol, alors qu'il sortait à peine de son ventre, un corps brun et ventru, qu'elle tâta et reconnut une fille. Les villageois firent un cercle autour de notre maison et couvrirent le jardin de fleurs blanches. On était au début de l'été. Quelques jours plus tard, alors que j'ouvrais à peine les yeux sur les formes qui m'entouraient, mon père me prit sur ses genoux et m'appela par mon nom. Le prêtre entra dans notre maison. Il tenait un voile transparent qu'il tendit au-dessus de mon berceau en bambou et mon grand-père se souvient qu'à cet instant je pleurais. Le prêtre soulignait mes paupières, mes joues et ma bouche mouillée avec son index tendu. On sentait l'odeur fade de l'huile à prière. Mes frères s'étaient approchés et effrayés retenaient leurs larmes, prêts à me défendre des gestes sacerdotaux.
 « Ne bougez pas, » sa voix me surprit dans ces souvenirs qui n'en étaient pas, que j'avais imaginés, tout autant que mon grand-père les avaient tissés dans mon esprit. A cet instant, c'est lui, ce vieillard, qui me manquait le plus. « Ne bougez pas, » répéta la voix, sans brusquerie, sans trace d'agacement. Simplement le sculpteur réclamait ma présence immobile. Je m'étais évadée et je repris la pose exigée par ma condition et par ces séances pendant lesquelles l'artiste cherchait à représenter mon corps ou plutôt ce qu'il devait évoquer. J'étais assise sur une natte, les épaules nues, un léger voile transparent jeté sur mes hanches et mes cuisses, les genoux joints, les pieds touchant le sol. Mon dos droit se dressait sans peine depuis une demi-heure et mon visage lisse gardait son indolence malgré l'attente. Depuis le début de la séance, je fermais les yeux , non pas parce que je craignais le regard de l'inconnu sur mon corps -j'avais pris l'habitude d'être dénudée aux yeux de tous- simplement je ne voulais pas être troublée par un autre. Je voulais me laisser envahir par des sensations, des formes imprécises ou des souvenirs sans trace d'émotions, pour le plaisir seul de faire naître des images derrière mes paupières. C'était la première fois que le sculpteur me parlait. C'était pour prononcer cette phrase : « ne bougez pas ». Je relevais un instant mes bras pour accrocher ma coiffure. J'ouvris les yeux et regardais cet homme. Il tenait à angle droit le couteau et tapotait à coups légers et fermes sur l'arrondi de mes hanches de marbre. Festival du Nu - Arles 2007 - Yves-Marie Jacob
« Ne bougez pas, » sa voix me surprit dans ces souvenirs qui n'en étaient pas, que j'avais imaginés, tout autant que mon grand-père les avaient tissés dans mon esprit. A cet instant, c'est lui, ce vieillard, qui me manquait le plus. « Ne bougez pas, » répéta la voix, sans brusquerie, sans trace d'agacement. Simplement le sculpteur réclamait ma présence immobile. Je m'étais évadée et je repris la pose exigée par ma condition et par ces séances pendant lesquelles l'artiste cherchait à représenter mon corps ou plutôt ce qu'il devait évoquer. J'étais assise sur une natte, les épaules nues, un léger voile transparent jeté sur mes hanches et mes cuisses, les genoux joints, les pieds touchant le sol. Mon dos droit se dressait sans peine depuis une demi-heure et mon visage lisse gardait son indolence malgré l'attente. Depuis le début de la séance, je fermais les yeux , non pas parce que je craignais le regard de l'inconnu sur mon corps -j'avais pris l'habitude d'être dénudée aux yeux de tous- simplement je ne voulais pas être troublée par un autre. Je voulais me laisser envahir par des sensations, des formes imprécises ou des souvenirs sans trace d'émotions, pour le plaisir seul de faire naître des images derrière mes paupières. C'était la première fois que le sculpteur me parlait. C'était pour prononcer cette phrase : « ne bougez pas ». Je relevais un instant mes bras pour accrocher ma coiffure. J'ouvris les yeux et regardais cet homme. Il tenait à angle droit le couteau et tapotait à coups légers et fermes sur l'arrondi de mes hanches de marbre. Festival du Nu - Arles 2007 - Yves-Marie Jacob votre commentaire
votre commentaire
-
Chaque matin, dès l'aurore, le sculpteur montait depuis le village jusqu'au temple. Du haut de la fenêtre du sanctuaire, je guettais son cheminement solide et solitaire. Je marchais avec lui dans ses pas. Quand il s'arrêtait pour regarder alentour la vue des dunes de sable qui encerclaient le village jusqu'à la mer, je mettais comme lui ma main au-dessus de l'arcade sourcilière pour voir, au-delà de la brume, l'horizon incertain flotter au-dessus de l'étendue marine. Je taillais le bout effilé du bâton qu'il avait laissé contre les pierres à l'entrée du temple. La première fois quand il leva la tête pour m'apercevoir derrière les barreaux en croix, je me suis rejetée vivement dans l'ombre de la chambre close. Après quelques jours, je lui souris sans crainte, avec cette confiance qu'on offre à un visage ami.
Le sculpteur était attendu à l'arrière du temple par les servantes qui s'empressaient de lui ouvrir l'entrée étroite. La porte se refermait, au dehors le monde s'éveillait. Les ânes se frottaient à l'écorce encore humide de rosée des arbres rabougris qui ornaient les champs, les femmes allaient puiser l'eau et les bêtes bruyantes dans les étables attendaient la traite. Un homme sur son perron d'ocre fumait l'échange du matin avec les dieux. Souvent le premier à prier était mon grand-père ; il avait entendu le sculpteur se lever et il se hâtait pour le saluer avant son départ. C'était lui qui avait surpris dans le visage du sculpteur les signes imperceptibles du changement. Il n'en fit aucune remarque, ni au sculpteur, ni aux villageois, ni même à moi. Dans la journée, quand il péchait, il murmurait « bien, bien » et c'était tout. A son retour de la pèche, il demandait à ma mère de préparer les poissons.
Rituel. Le sculpteur s'asseyait dans la cour fraîche du temple et les servantes lui offraient une boisson parfumée aux plantes des montagnes pendant que d'autres dans la chambre s'affairaient auprès de moi, la jeune prêtresse. Je tentais de me souvenir, du temps où je vivais paisible dans mon village, avant que le prêtre ne m'ait choisie.à suivre
 votre commentaire
votre commentaire
-
Elle se tenait debout devant ma bibliothèque et je la voyais poindre son révolver dans ma direction. J'étais incapable de savoir si, oui ou non, l'arme était chargée. Je me contentais de me tenir à l'abri derrière le dossier de mon fauteuil, à genou sur le plancher, dans un geste de suppliant. Entre ses phrases criées, indistinctes, le silence de mon bureau. Dehors, sur les quais, les voitures attendaient que le feu passât au vert. Il m'était impossible de me pencher à la fenêtre de mon cabinet pour crier aux conducteurs dans quel danger je me trouvais, ce vendredi vers 14 heures en plein cœur de la cité. J'attendis encore dans cette fâcheuse posture que la jeune femme se calmât. Au fond, je savais qu'en aucun cas je n'aurais pu jeter au monde un « sauvez-moi », j'étais trop dépité de me retrouver ainsi dans la pointe de mire d'une patiente qui me tenait à sa merci et qui me faisait goûter à l'effarement.
J'évoquais un bref instant le regard de mes pairs penchés sur cette scène qui n'avait rien de biblique. Cette ligne de mire me remettait en cause, et pour tout dire me reléguait au ban de ma société.Retour arrière. Je suis psychanalyste, freudien. J'exerce dans mon cabinet à titre indépendant, je consulte également à l'hôpital psychiatrique des Pénitents, grande bâtisse XIXe, bordée de son parc ombragé à l'entrée de la ville. Enfin, le mardi et le jeudi, je professe à l'université pour les étudiants du DESS de psychologie clinique. J'ai acquis en vingt années de métier une solide réputation, la confiance de mes pairs, le respect, voire l'admiration, de mes étudiants, et de réels progrès de mes patients. J'accumule avec mes conférences, mes articles, une certaine notoriété, au moins dans le petit monde de la psychanalyse freudienne, qui dépasse le cercle de ma ville provinciale et remonte par les courants jusqu'à Paris, où certaines de mes hypothèses, pas encore des théories, sont commentées dans la presse spécialisée. Je peux, sinon m'enorgueillir, au moins me satisfaire de mon parcours et, les nuits d'insomnie, énumérer mes brillantes étapes.
Lorsque j'ai reçu Patricia pour la première fois dans mon cabinet, j'étais parfaitement conscient de ses difficultés psychologiques. Patricia est une jeune femme de vingt-quatre ans, plutôt jolie, à la bouche peut-être trop fine -certains vous diront qu'elle dénote son manque de confiance mais je n'aime pas les raccourcis trop rapides. De longues jambes, un corps élancé, une courte chevelure brune. Des cils épais, un regard... voilà c'est ça qui frappe : son regard, lointain et vague. Lorsqu'elle vous regarde, Patricia vous annonce non pas des tempêtes mais des orages d'été : ceux qui apaisent quand la tension de la chaleur a été trop forte. Au cours de ce premier rendez-vous, je l'ai écouté exposer dans un long monologue -les monologues se prêtent à ma profession plus que les dialogues- ses difficultés, ses souffrances, en mots courts et essoufflés. Patricia appartient à une famille plutôt bobo, comme on dit, ouverte à la psychanalyse, relativement cultivée, son père est architecte.
Patricia a été quelque temps étudiante aux beaux arts, puis en littérature comparée, et finalement en ethnologie. Rien de concluant, me dit-elle, ses difficultés de vivre l'empêchant de conclure dans ses études. Je l'ai écouté avec toute l'attention que ma profession nécessite. J'avais déjà compris par sa présentation hachée, ses respirations, ses détournements, que je n'avais pas affaire à une patiente habituelle. Il est bien connu que la cure psychanalytique ne soigne que les névroses, quand elle y parvient. La règle est simple : en cabinet, un freudien ne soigne pas les psychoses, obligation de se référer à un autre cadre. La déontologie de l'obédience freudienne, à laquelle j'adhère pleinement, est très explicite sur ce point. Je n'ai qu'à m'y conformer et à renvoyer Patricia auprès du Centre des Pénitents. Rien d'autre à décider. Au lieu de quoi, orgueil, direz-vous, je me remémorai mes récentes hypothèses, tout mon parcours -je ne vous le refais pas une deuxième fois- et je déclarai en un claquement de doigts : « J'ai une place pour vous, les vendredis à 14 heures, cela vous conviendrait-il ? » C'est ainsi que Patricia, une patiente psychotique, entama une cure psychanalytique dans mon cabinet.
C'est ainsi que, ce vendredi, je me retrouvai dans sa cible de mire. Impossible d'appeler au secours, je tentai de lui parler, mais les mots ne venaient pas, seules défilaient des images, des sons, la sortie de mes élèves après mes cours, leurs questions, les tentatives de séduction de certaines de mes plus jolies élèves, les échanges avec les autres membres de mon groupe psychanalytique. « Comment avez-vous pu, vous, enfreindre à notre déontologie ? », j'entendais déjà la présidente du groupe m'invectiver. Tout cela ne me donnait pas la réponse à ma situation qui empirait. Je regardais Patricia, debout, l'arme pointée dans ma direction. J'étais désarmé. Toute mon intelligence, toutes mes théories s'évanouissaient. Je vacillais, j'allais devenir fou, oui, moi aussi, j'allais devenir fou. J'en aurais pissé dans mon froc. Comment faire pour sauver ma peau, enfin sauver la face, et rétablir le dialogue avec ma patiente ? Comment dit-on chez les flics ? Le négociateur. Négocier. Rien. Ca ne sortait pas. Je ressentais une agression si forte que rien ne pouvait lui résister. Et là, croyez-moi, ne me croyez pas, j'ai eu la révélation. Ouais, comme Saint Paul. C'était une évidence : Patricia tentait de me faire ressentir ce qui l'habitait continuellement, le sentiment d'agression qu'elle subissait sans répit, qu'elle éprouvait jusque dans mon cabinet et que son révolver dévoilait. Son geste, dont les ressorts étaient parfaitement inconscients, fit soudain sens. Ma patiente, dans ce détour, avait trouvé le moyen de communiquer avec moi. Dans ce moment, je dépassais l'empathie et je parvins à une symbiose salvatrice. C'est ce que je parvins à lui transmettre. Toute la tension de son geste s'apaisa, délivrée par ma parole. Je réussis à la désarmer. La situation retrouva son équilibre, au moins momentanément : elle la patiente, moi le psychanalyste.
Depuis lors, je poursuis avec Patricia cette tentative de cure et je constate les progrès de ma patiente. Je ne sais pas encore où nous conduira cette expérience, mais je sais désormais que la compassion est une arme efficace pour faire reculer les frontières de la souffrance.
photo : Franck Donat, Rues de Lyon
http://ruesdelyon.wysiup.net/PageRubrique.php?ID=1002420# votre commentaire
votre commentaire
-
Africaine,
J'attache dans mon dos
Mon petit enfant
Asiatique,
Je médite sous le grand arbre
Avec mon maître gurûkula
Européenne,
Je perds mes certitudes
Avec mon penseur de dé-raison
Américaine,
Je guette la voilure
De mon conquérant
Océanique, je te rejoins
Dans la chambre d'écorce
Du temps des rêves.
Antarctique,
Tu me magnétises
Dans tes éternelles glaces
Perdus, éperdus
Aux cimes de tes monts hallucinés
Pour la nuit des temps.Photo : Michel UDNY
 votre commentaire
votre commentaire Suivre le flux RSS des articles
Suivre le flux RSS des articles Suivre le flux RSS des commentaires
Suivre le flux RSS des commentaires
Nuits blanches
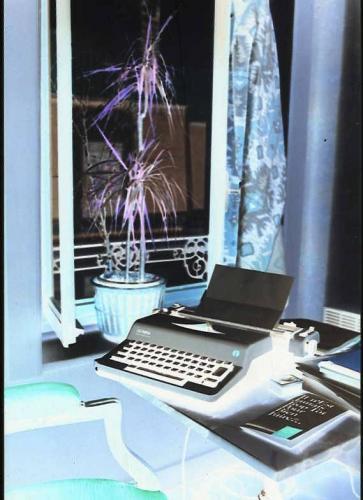
 Twitter
Twitter del.icio.us
del.icio.us Facebook
Facebook Digg
Digg Technorati
Technorati Yahoo!
Yahoo! Stumbleupon
Stumbleupon Google
Google Blogmarks
Blogmarks Ask
Ask Slashdot
Slashdot

