-
Je me sens bien ce soir. Je regarde autour de moi l'agitation sereine.
Dans la rade -peut-on parler de port ?- le bateau plein de lumière s'apprête au départ. Ses cales sont bondées de camionnettes, où s'empilent, incroyables, des cagettes vides, prêtes à basculer sur les motocycles, les cages de poules, les ballots. Sur les ponts de bois, les Grecs mêlés aux touristes attendent la sirène du départ. Mais le capitaine n'est pas pressé. Il serre contre lui son carnet noir et regarde le disque rouge glisser par-dessus le faîte des monts. Il ne partira pas avant que la montagne n'ait avalé le dieu. Il a tout le temps pour sonner l'heure où l’on remontera l'ancre. La chaîne frottera au flanc du bateau et, lourde, humide, reprendra place contre la coque trop tendre par son fer usée.
Autour de moi, les tables des tavernes déversent leurs vins, leurs cafés et partout viennent des odeurs de viande grillée. Les hécatombes sont prêtes pour les dieux. Je voudrais être aussi astucieuse qu'Ulysse et formuler un vœu entendu par les dieux.
Mais Athéna dort en Olympe. Sa chevelure déroulée s'étale sur les toisons bouclés des moutons sacrés. Elle a déposé contre le marbre de sa demeure son bouclier et sa lance pointue. Apollon a recouvert sa nudité et frileux préfère la chaleur des charbons ardents à la douce musique de sa lyre. Dionysos oublié ne s'est pas encore révolté. Il apparaît dans une nuée, regrettant amèrement le vin doux de sa jeunesse. Quand la terre, jeune fille, l'accueillera-t-elle de nouveau pour fêter sa dernière naissance ? Les dieux auraient-il jugé que nous n'avons plus besoin d'eux pour régler nos amours et nos querelles ? Ou bien sont-ils devenus impuissants ? Jaloux de nos pouvoirs démesurés, ils refusent, désormais d'apporter leurs fronts lisses et restent cachés dans l'éther que les astronomes attaquent de leurs yeux pénétrants. Attendre, attendre qu'Athéna s'éveille, qu'Apollon s''échauffe à nouveau, que Dionysos renaisse. Le temps suspendu.
Le capitaine a levé la main pour annonce le départ et le premier pilote baisse la manette. Quand la nuit tombe, sur la mer déjà noire, le bateau s''écarte des lumières de la côte et rejoint l'horizon brumeuse. La sirène retentit, le capitaine a tenu jusqu'au bout son bateau et ne sera parti qu’après le plongeon silencieux du soleil. votre commentaire
votre commentaire
-
Aujourd'hui le Péloponnèse. J'y ai croisé une Hélène précoce. Sur une place dallée de Nauplie, elle promenait sa jupe plissée à carreaux écossais. Elle pouvait avoir au moins trois ans. Bien que les tavernes allongeassent leur terrasses tout autour, la place était plutôt calme : nous sommes en Grèce et après que le soleil éblouissant se soit retiré, les Grecs oubliant la chaleur du jour, reprennent leurs principales activités : lire les journaux, boire un frappé et bavarder avec les amis de toujours.
C'est donc dans cette douce quiétude que la petite apparut. Elle avait derrière elle deux prétendants l'un en culottes courtes, l'autre arborant des pantalons bouffants, rose indien. La petite Hélène -la destinée l'avait déjà touchée- avait porté sa préférence sur celui aux jambes couvertes. L'autre assistait plutôt qu'il participait. Bref, je regarde ce trio enfantin, l’œil humide, le sourire aux lèvres émue par leurs jeux innocents.
Hélas, la petite se transforma en chipie sans qu'on sut très bien les motifs d'un tel changement. Est-ce la lune qui à cet instant se levait et soupirait jusqu'à terre ou simplement un insecte buveur de sang qui piqua l'heureuse enfant ? Ou bien encore une pensée née de la rencontre néfaste de deux électrons parasites ? L'histoire ne saurait le dire. Pourtant ce qui est sûr, c'est le geste prompt et énergique qui soudain poussa le malheureux prétendant. La chipie des deux mains presse sur les épaules et le jeune enfant, non encore parvenu à l'éphèbe, aux jambes en cerceaux, fléchit de tout son poids, arrête ses fesses grossies par les couches sur le sol dallé.
Un temps où rien ne se passa suivit cette chute lourde. L'autre prétendant, impressionné, regardait son rival en si mal posture. La chipie, toujours debout, bien que chancelante après l'effort qu'elle avait fourni, restait perplexe. Comment, par une simple poussée, avait-elle pu détruire l'équilibre vertical du bambin ? Elle hésitait entre le mépris et le rire puis préféra relever celui qu'elle venait de bafouer, ne supportant pas qu'elle puisse s'attacher à un si piètre amoureux. Des deux mains, elle accrocha la chemisette blanche de l'autre toujours assis. Il faut dire, pour que la scène soit bien décrite, que le pauvre avait chu sans retenue, sans un soupir non plus, comprenant mal l’acte, et resta flegmatique. Tout le désarroi de l'humanité masculine face à l'incohérence féminine se reflétait dans sa bouche dodue. Bref, il attendait la suite, certain qu'elle serait dure.
Et voilà que la belle Hélène aux tresses noires avance ses mains vers lui et l'attrape par les épaules pour l'aider à redresser son corps affalé. Vraiment, il ne s'attendait pas à cette commisération et incapable d'aucun mouvement il attend qu'elle le relève. Ho hisse ! Une fois ! Deux fois ! Hélène manque de force et son prétendant reste là assis. A ce moment en suspens, la mère surgit et rectifie l'équilibre de son petit, le redresse de toute sa taille, le porte contre sa poitrine et son ventre, l'encense et le rassure. La belle Hélène qui a perdu son premier amoureux, reçoit une verte réprimande.
Le bambin, protégé par les bras maternels, poursuit sa réflexion et pense que les femmes ne sont possibles que lorsqu'elles sont mères. Mais là encore il doute et n'aura de cesse de retrouver la ferme volonté d'une petit Hélène qui le balance par terre et tente de le relever ensuite : quelle douceur, pense-t-il, de s'abandonner ainsi aux fantasques mouvements des femmes.
Qu'est devenu le second prétendant ? L'histoire ne le dit pas. Parions que la belle Hélène, oublieuse l'aura laissé là sur la place, car après tout, il lui fallait un spectateur et un acteur pour jouer sa scène. Le spectacle terminé, elle s'est promenée jusqu'au bout de la place et là s'est assise sur une balançoire abandonnée. A cette heure-ci, elle se balance encore et personne ne connaît ses rêves quand elle soulève ses jambes bien haut vers le ciel étoilé de la Grèce.
 votre commentaire
votre commentaire
-
Au fond vous êtes bien plus bavard que moi. Vous ne cessez de me poser des questions et il me semble que si nous avons abordé beaucoup de sujets, nous n'avons fait que les effleurer. Au fond, nous n'avons rien dit, c'est l'effet bistrot. Pourquoi vous ai-je parlé de Blandine ? Après tout, j'aurais pu tout aussi bien vous parler de Florence ou de Pascaline. Je sais ce que vous allez me dire. Pourtant vous n'y êtes pas du tout. Blandine n'est pas la dernière femme que j'ai connue ni même qui m'ait aimé. Est-ce la dernière que j'ai aimé ? Peut-on en être certain ?
Un dimanche, je décidais d'emmener Blandine au parc. Je n'aime pas les promenades à la campagne. Surtout le dimanche, c'est déprimant. Je préfère la campagne de nuit, dans des lieux obscurs. Le dimanche, vous sortez de la ville derrière une file de promeneurs qui comme vous souhaitent respirer l'air pur. Est-ce vraiment leur motivation ? Je crois plutôt que nous agissons par manque d'imagination. Quand les musées ne vous agréent plus, quand la plupart des cafés que vous aimez sont fermés, à part celui-ci. Mais je ne peux tout de même pas rester ici toute une journée, n'est-ce pas ? Donc, la seule promenade que je supporte le dimanche, c'est d'aller au parc. Les jardins sont préférables aux champs. Avez-vous déjà fait l'expérience de trouver un lieu sans avoir à rouler pendant des kilomètres, où l'herbe est tendre et verte, les arbres bien plantés, où à coup sûr vous ne trouverez pas une barrière en fil de fer qui vous oblige à l'enjamber et à déchirer votre costume ? A la campagne, l'herbe est grise, c'est de la mauvaise herbe, dure, tordue, jonchée de détritus laissés par d'indésirables prédécesseurs. Et allez chercher des fleurs dans cet amas informe ! Quelques marguerites frêles et poussiéreuses, sorties de là comme par hasard, osant à peine se montrer. Et s'il vous prend l'envie, au mois de mai, de cueillir du muguet, à moins de venir très tôt, ce que je ne saurais faire, vous ne trouverez rien mais vous gagnerez en revanche un lumbago à force de vous baisser, si ce n'est une avalanche d'éraflures, de coups de toutes sortes à vous être frotté à ces broussailles et ces branches mortes qui encombrent nos forêts. Je ne parle même pas des familles bruyantes que vous croiserez, ni de l'agacement que vous aurez lorsque, attablé dans une auberge, on vous servira des crêpes à peine cuites et où l'on vous fera attendre inutilement dans une salle sans goût, sentant le rance. Il n'y a qu'à la campagne que vous trouverez de tels désagréments, vous ne me ferez pas changer d'avis. Certes, je ne suis pas crédible, peu importe. L'air des villes me convient et je ne comprends pas cet engouement pour le retour à la nature. D'ailleurs, j'ai le rhume des foins et le printemps, comme l'été, je fuis tout ce qui est vert et fleuri. Il est vrai que j'accepterais le retour à la nature dans un monastère perché sur la pointe d'une montagne, loin des hommes en somme. L'homme est fait pour vivre dans la cité. Je n'invente rien, un penseur l'a déjà dit. Je ne vous ferai pas l'affront de préciser lequel, d'ailleurs j'ai oublié son nom.
C'est donc pour toutes ces mauvaises raisons, qu'en ce dimanche de printemps, ne sachant que faire de Blandine et constatant qu'elle ne me lâcherait pas, je décidai de l'emmener au parc. Pour une jeune fille, c'est déjà une promenade romantique. Pour moi, c'était une façon commode de passer le temps. Nous en étions aux premières rencontres et pourtant il me semblait déjà imprudent d'emmener Blandine n'importe où, je veux dire dans des lieux où je risquais de rencontrer des amis. Habituellement, avec une femme, je m’arrange pour espacer les rendez-vous ou les circonscrire dans des lieux neutres. Cela ne pose pas de problème. Il en allait tout autrement avec Blandine. Il me fallait ménager sa susceptibilité qu'elle avait grande. Je ne sais pourquoi, en outre, cette simple promenade me semblait déjà une imprudence. Quant à Blandine, elle, elle rayonnait. Cela ne dura pas. A peine avions-nous croisé la statue aux colombes qui frissonne dans l'allée de la roseraie, qu'une scène aussi violente qu'inattendue secoua l'alentour. Blandine était blanche, hurlait presque et prenait à témoin les pauvres passants. Je restais coi. Je ne soupçonnais pas que cette enfant fragile pût se comporter avec autant de nervosité et de courroux. J'en étais à chercher quelque exemple dans la littérature quand je la vis s'enfuir, perdant même une chaussure dans le gravier de l'allée. Bon, je restais là, gauche, avec sa chaussure à la main, que j'avais ramassé machinalement, souriant aux passants qui me fixaient bizarrement. La rapidité de la scène, son absurdité, m'interdisaient toute réaction. Comment pouvais-je agir avec raison après ce sursaut démoniaque ? En outre, Blandine avait disparu si rapidement qu'il m'était impossible de la retrouver. Je pris le parti de m'asseoir sur un banc et d'attendre la suite des événements. Après tout, je tenais sa chaussure, elle serait obligée de revenir, quoi qu'au fond je doutais qu'elle pût avoir ce souci. Comment pouvait-on espérer une conduite raisonnable après cet éclat ? J'essayais de comprendre ce qui lui avait causé un tel émoi. Il me fallut quelques efforts car à chaque tentative pour me remémorer nos dernières paroles j'étais sans cesse attiré par d'autres détails, qui une fleur de la roseraie nouvellement aperçue dont le rouge ou le blanc me laissait sans voix, qui une jeune femme fleurant bon qui longeait l'allée au bras d'un homme ou tenant un enfant par la main. Finalement, cette introspection me permit de conclure que tout avait commencé après que j’eus croisé Muriel, une ancienne amie. Nous n'avions échangé qu'un bonjour poli, l'homme qui était avec elle s'était éloigné, par discrétion, et Blandine avait jugé bon de calquer sa conduite sur la sienne. Immédiatement après, elle me demanda effrontément qui était cette femme que j'avais saluée. « C'est Muriel, une amie. » avais-je répondu laconiquement, n'attachant après tout aucune importance à cette rencontre de hasard. Pour Blandine, il en allait tout autrement, ce dont évidemment je ne pouvais me douter. Enfin, je me souvins qu'une de ses dernières phrases avant de s'enfuir avait été : « Alors, moi aussi, si tu me rencontrais par hasard, tu n'aurais pas plus d'égards ? » Sur le coup, je n'avais pas compris le sens de cette phrase -faut-il d'ailleurs en chercher du domaine de la raison vous l'aurez compris ? J'en étais là de mes réflexions quand, tout aussi soudainement qu'elle avait disparu, Blandine se dressait devant mon banc. « Ne crois pas que je suis venue pour te pardonner. Je viens récupérer ma chaussure. » « Voilà » Je lui tendis l'objet et lui demandai de s'asseoir pour se chausser plus aisément. Il me semblait qu'une fois assise, elle saurait m'écouter. Dans son état, je n’osais même pas lui prendre la main et me souvins d'un film où, pour calmer une jeune fille, le héros pressait son genou. Je n'étais pas très clair, je faillis murmurer son nom mais me contins. Parfois il est préférable de rester silencieux. Quelques secondes à peine passèrent et je l'entendis pleurer doucement comme un enfant pris en faute. Je ne résistais pas.
Vous me dites qu'à ma place vous auriez abandonné la partie ? Si sa colère avait été sensée, fondée, sans aucun doute. Je ne peux pas supporter les femmes irascibles. Mais là, c'était tout différent. Il y avait quelque chose de fascinant dans ce délire et bien que je prévoyais déjà les mille tourments que cette âme allait faire peser sur moi je demeurai. Est-ce qu'elle-même comprit le goût que j'avais pour les situations exaspérantes ? Sur ce banc, c'est un pacte que nous scellions, un pacte muet, et comme celui de Faust, la mort seule pourrait le délier.
Non rassurez-vous c'est une phrase de circonstance, pour dramatiser, dessiner l'enjeu bien littéralement. Oui tout est littéraire. Il est vrai que nous pourrions verser dans le romantisme noir. votre commentaire
votre commentaire
-
Le matin, à neuf heures, ce sont les industriels, les commerciaux qui prennent un café en vitesse avant le début de la journée. Soyez tranquille, à cette heure, pas d'étudiants. Ils dorment encore. Là vous entendez des propos très sérieux. Qui commence toujours pas : « Comment vas-tu ? Beaucoup de travail ? » « Je suis débordée. Le nouveau commercial ne passe pas. Mademoiselle Fine de la Sfar est furieuse. Tout l'après-midi d'hier j'étais au téléphone, tantôt avec l'un, tantôt avec l'autre, horrible ! » Et il y a cette brune, c'est une femme que j'admire beaucoup. Vous voyez cet immeuble repeint là-ba derrière la rangée d'arbres ? Il est à elle, elle a ouvert une boîte de conseil, ne me demandez pas en quoi. Elle vient quelquefois à ma table quand ses affaires l’inquiètent et qu'elle n’a pas envie d'en parler à ses messieurs en costume... Comment je l'ai séduite ? Nous étions à la même table, un jour où une connaissance commune nous avait réunis par hasard. Tous deux parlaient affaire, la vie chère, le gouvernement qui freine l’action des entrepreneurs, les fusions, les rachats des grands groupes. J'étais censé écouter, avant d'autant plus de sérieux que je faisais du pied à cette belle femme. Quand elle s'en aperçut, elle me regarda curieusement puis trouva cela drôle et le lendemain, dès qu'elle entra, elle vint s’asseoir à ma table.
A onze heures, ce sont les professeurs qui, leurs cours terminés, viennent ici régler quelques problèmes épineux et se plaindre que la faculté ne leur accorde même pas un bureau tranquille. Là les conversations sont tout aussi importantes. De loin, vous ne verriez aucune différence, c'est le même ton. Si vous vous rapprochez, vous constaterez que le sujet est tout différent : « Ah non, c'est impossible. Vous ne pouvez pas admettre que ces tribus existaient déjà au Paléolithique supérieur. » Enfin quelque chose qui y ressemble. « C'est vrai, il y a Lascaux, mais tout le formulaire, la langue ! Non, ça ne colle pas. Ou alors... » Ou alors leur théorie tombe à l'eau et en entendant ils se plongent dans un café fumant, espérant que le monde n'y verra que du feu. S'ils sont très honnêtes, intellectuellement, ils remettront tout en question et le lendemain reviendront un sourire aux lèvres, ayant pris en compte une nouvelle donnée qui soutiendra la fondation de leur hypothèse.
Oui, bien sûr, ceux du ministère viennent aussi. Ce sont le plus souvent des secrétaires, des sous-chefs de cabinet. Des gens biens. Importants. Ennuyeux. En avril dernier -je me souviens très bien du mois car au même moment, une vieille dame me recommandait de ne pas me découvrir d'un fil, selon le dicton. Les vieilles femmes adorent les adages, parce qu'elles, elles les suivent à la lettre et pour rien au monde ne quitteraient leur cher imperméable tant que mai n'est pas installé au calendrier. Ce jour-là, donc, la porte, celle du devant qui donne sur le boulevard, fut poussée d'un seul coup : un homme, grand, imposant, le cheveu et le regard noirs, envahit l'entrée. C'était Georges Blanc, le député. Derrière lui suivait un secrétaire. Ils étaient pressés et se firent servir au bar. Un troisième personnage les rejoint bientôt et je compris à l'air contrarié du député qu'un contre-temps les obligeait à rester plus longtemps que prévu ici. Ils voulurent donc choisir une table et je ne sais pourquoi, le secrétaire, m'ayant reconnu, s'avança à la mienne. Il était trop tard quand il réalisa que le député était peu enclin à s’asseoir à la table d'un inconnu. Je ne pouvais que sortir de l'embarras ce jeune secrétaire et sus, par quelques tournures, dérider le député. Il devint même prolixe et voulut dire quelques bons mots. C'est là le rôle de celui qui aspire à un rôle : il lui faut chaque jour prouver qu'il est à la hauteur de sa tâche. Voyez-vous, l'homme politique se veut le guide du peuple, il n'aura donc d'autres soucis que de prouver sa lucidité, sa compétence. Georges Blanc est le parfait exemple de l'arriviste politique. Avez-vous lu son livre ? Rien de plus commun que ses idées, ce sont celles de tout le monde, mais il les exprime bien et chacun s'y reconnaît. Comment, vous ne vous doutiez pas de l'impact de cet homme ? Nous en étions à parler des relations humaines, ce qui vient vite dans un lieu de rencontre comme celui-ci. « Monsieur, le député prenait un ton de confidence mais élevait la voix, nous ne devons plus dire comme Descartes, « Je pense, donc je suis » mais bien plutôt « Je communique, donc je suis. »
Dites, vous n'êtes pas de ces gens qui se glorifient de fréquenter des gens importants, n'est-ce pas ? C'est un trait de caractère qui m'a frappé chez un jeune homme au demeurant très prometteur. Sa situation d'étudiant le rendait soucieux. A vingt-huit ans, il s'inquiétait de n'avoir encore rien prouvé. Il est des hommes pour qui l'action est une bannière, je ne parle même pas des militaires ou des entrepreneurs. Mais, voyez-vous, ce jeune homme, révolutionnaire en puissance exilé de son propre chef de son pays, ne pouvait s'empêcher de nommer ses relations par leur profession, ou à défaut par leurs activités. Comme il lui était difficile de me qualifier de la sorte et bien que ma compagnie lui plût, il s'était convaincu que j'étais un homme d'importance et d'un tacite accord me présentait à ses propres amis comme un poète. Cette définition lui convenait, quant à moi elle me flattait je l'avoue. Par je ne sais quelle facilité, je m'étais laissé aller à lui parler de quelque poésie écrite par moi. A l'époque, il est vrai, j'aimais écrire à mes amies de longues lettres enflammées, que je n'envoyais jamais ou très rarement. Il m'était donc aisé de prendre ces propos d'amour pour de la poésie. La poésie n'est-il pas pas le chant de l'amour ? D'ailleurs, j'avais quelque talent et je me suis passionné, un temps, pour ces écrits. Donc, à cette époque, j'étais poète et mon révolutionnaire plaignait les artistes incompris, tout comme les prophètes -entendez, les révolutionnaires- dans leur propre pays. Je ne devrais pas parler avec légèreté de ce jeune homme. Grâce à lui, j'en sais plus long sur les théories révolutionnaires mais à l'époque je fréquentais aussi un groupe d’anarchistes et n'ai jamais pu trancher entre la théorie marxiste et l'anarchie. Mon révolutionnaire était marxiste-léniniste convaincu et regrettait de ne pouvoir m'ouvrir les yeux. Toutefois, il me pardonnait puisque j’étais poète ; en outre, nous partagions le goût des femmes et nous trouvions dès lors un terrain d'entente quand les discussions trop politiques m'ennuyaient ouvertement.
Quatre heures, c'est l'heure que je préfère. Bientôt vont arriver toutes les jeunes femmes désœuvrées qui auront passé leur après-midi en quête d'achats, de frivolités. Ne m’accusez pas d'être sexiste -on dit cela, n'est-ce pas ? Ce n'est qu'une affaire de culture après tout. Allez en Italie et vous serez frappé du nombre d’hommes qui s'arrêtent devant les vitrines, s'habillent avec recherche et surtout en parlent comme d'une chose naturelle. Ici, quoique l'homme s'habille, il feint de ne pas y attacher d'importance. Donc, ces femmes entrent ici pour boire un thé ou un jus de fruit, selon la saison, et se mettent à rêver ou à chercher, selon l'âge, un inconnu, avec qui elle pourrait oublier leur ennui, en attentant l'heure où elles iront récupérer les enfants à la sortie de l'école. Quand elles sont seules, elles sont charmantes, avec leur mère ou leur belle-mère, elles sont pathétiques. Que voulez-vous, les groupes détruisent toute spontanéité, toute véracité. A se réjouir faussement pour des choses sans importance, on devient rapidement soi-même sans intérêt.
Est-ce que j’ai continué d'écrire ? Des lettres surtout. J'ai commencé un roman, évidemment, qui n'a pas commencé à écrire un roman ? Puis j'ai renoncé. Tout le monde écrit, alors à quoi bon ! Et surtout, à cause de Dostoïevski et de Nastasya Filippovna. A lire cette scène admirable où la jeune femme renonce à l'amour parce qu'elle se persuade d'être indigne du prince, je pleurais monsieur. Dostoïevski m'arrachait des larmes. Cette souffrance, je me demande même si une femme me l'a fait autant éprouver. Blandine peut-être. Tout à coup, je me suis senti indigne d'écrire un roman. Parce que pour cela, il faut être intense, vivre, sentir, avec intensité. Je vous l'ai dit, l'intensité m'enthousiasme. Blandine m'aimait intensément. C'en était effrayant et moi, cruel, je lui ai interdit de m'aimer.
 votre commentaire
votre commentaire
-
C'est la première fois que vous venez dans ce café sans doute, je ne vous y ai jamais vu. Moi, c’est mon fief. Ce café est rare. Voyez ses décorations, c'est le grand Parelli, celui de Florence qui les a dessinées, avant qu'il ne soit célèbre. Depuis un siècle, les patrons ont respecté ce décor. Toutes ces nouvelles couleurs qui sont choisies ailleurs, et ces matériaux, l'inox, le plastique, pouah !Je ne les supporte pas. Surtout là, vous êtes au cœur du meilleur quartier de la cité. A droite les universités, à gauche les banques et derrière vous le Ministère. Je n'en dis pas plus. Il suffit de venir à des heures différentes et vous connaîtriez toutes les nouvelles du monde les petites et les grandes.
 votre commentaire
votre commentaire Suivre le flux RSS des articles
Suivre le flux RSS des articles Suivre le flux RSS des commentaires
Suivre le flux RSS des commentaires
Nuits blanches
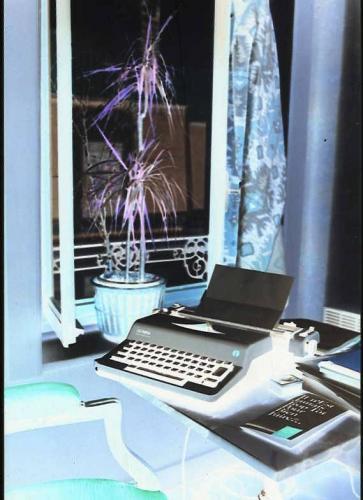
 Twitter
Twitter del.icio.us
del.icio.us Facebook
Facebook Digg
Digg Technorati
Technorati Yahoo!
Yahoo! Stumbleupon
Stumbleupon Google
Google Blogmarks
Blogmarks Ask
Ask Slashdot
Slashdot




